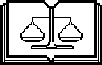|
Divers aspects de l’équité de la procédure
• Loi rétroactive et intervention du législateur
dans les procès en cours :
l’affaire Zielinski et Pradal & Gonzales et autres
(arrêt du 28 octobre 1999)
par
Me
Vincent DELAPORTE
Avocat
aux Conseils
1
• L'arrêt rendu dans cette affaire par la CEDH sanctionne la France à
raison d'une intervention législative destinée à imposer aux juridictions la
solution de divers litiges dont elles étaient saisies.
Ces
litiges portaient sur le montant de l'indemnité dite de "difficultés
particulières", qui est payée aux salariés des caisses de sécurité
sociale et d'allocations familiales des trois départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle. On sait que dans ces trois départements, qui sont en
France, le droit commun est, selon les cas, complété ou écarté par une législation
spéciale dite de droit local. Ce droit local est-il d'une complexité telle
qu'elle rende son application plus difficile que le droit commun français ? Il
faut le croire puisque c'est la raison qui a été avancée pour justifier
l'octroi aux salariés des caisses de sécurité sociale d'Alsace-Moselle de
cette "indemnité de difficultés particulières", prévue par un
protocole d'accord signé entre les caisses et les syndicats régionaux le 28
mars 1953.
Ce
protocole de 1953 dispose que la prime, versée chaque mois, "est calculée
en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective
nationale du personnel des organismes de sécurité sociale... multipliée
par 12".
La
convention collective ainsi visée était celle du 16 octobre 1946, en
vigueur au moment de l'accord de 1953, et qui a été ensuite remplacée par une
autre convention collective du 8 février 1957. L'entrée en vigueur de cette
nouvelle convention collective en 1957 n'a pas suscité de difficultés
particulières. Mais il devait en aller autrement d'un avenant du 10 juin 1963,
lui aussi appliqué sans difficulté pendant vingt-cinq ans, avant que certains
salariés ingénieux n'aient songé à en tirer un parti avantageux.
En
effet, la valeur du point, à laquelle se référait l'accord de 1953, avait été
fixée en fonction de la classification des emplois et de la grille indiciaire
telle qu'elle résultait de la convention collective de 1946. Cette
classification et cette grille étaient demeurées inchangées jusqu'à
l'avenant du 10 juin 1963 qui la bouleversa complètement, de sorte que la
valeur du point dans l'avenant de 1963 était deux fois celle qui résultait de
l'accord de 1946. Si on avait pris à la lettre l'accord de 1953, en appliquant
le coefficient 12 sur la valeur du point résultant de l'avenant de 1963,
l'indemnité de "difficultés particulières" se serait trouvée
brusquement multipliée par deux. C'est pourquoi, spontanément, sans opposition
ni même discussion, les caisses de sécurité sociale d'Alsace-Moselle, tenant
compte du fait que le point avait pratiquement doublé, ont retenu le
coefficient 6 et donc fixé le montant de l'indemnité à six fois la valeur du
nouvel indice, ce qui avait pour conséquence de maintenir le montant de la
prime à un niveau constant. Le procédé n'a suscité alors aucune opposition.
La
même opération a été effectuée à l'occasion d'un nouvel avenant apporté
le 17 avril 1974 à la convention collective, qui modifiait à nouveau la
classification des emplois et la grille indiciaire. Si on avait maintenu le
coefficient d'origine (12), la prime aurait été multipliée par trois. Les
caisses ont alors fixé le montant de la prime de "difficultés particulières"
à 3,95 fois la valeur du nouveau point d'indice. Là encore, le changement de
coefficient assurait la constance du montant de la prime, qui suivait également
la revalorisation régulière du point d'indice.
Ni
après 1963, ni après 1974, le nouveau coefficient de calcul de l'indemnité
n'a suscité de protestation. Autant qu'on puisse le savoir par les mémoires et
l'arrêt de la Cour, aucune procédure judiciaire n'a été engagée avant 1988.
Cela veut dire que pendant 25 ans, les caisses ont considéré, sans opposition
des salariés et des organisations syndicales, que la revalorisation du point
indiciaire de référence devait entraîner une modification du coefficient
multiplicateur permettant de déterminer l'indemnité de "difficultés
particulières". Cette interprétation avait pour elle le bon sens. Comment
imaginer que les partenaires sociaux aient voulu multiplier l'indemnité par 2
en 1963 et par 3 en 1974 de façon simplement tacite, sans aucune discussion ?
Comment déduire une telle volonté de l'adoption de deux avenants qui n'avaient
pas cet objet ? On peut comparer la situation au passage, en 1959, des
"anciens francs" aux nouveaux francs qui, à l'évidence, n'avait ni
pour objet ni pour effet de multiplier par 100 les obligations de sommes
d'argent libellées en francs.
Une
pratique constante de vingt-cinq ans n'a cependant pas dissuadé certains salariés
de saisir les tribunaux en 1988 pour demander l'application littérale de
l'accord de 1953, en réclamant, sur toute la période non couverte par la
prescription quinquennale, le complément d'indemnité de "difficultés
particulières" calculée sur la base du nouveau point indiciaire multiplié
par 12 et non plus par 3,95.
Les
salariés demandaient également une revalorisation de la prime annuelle de
treizième mois, par voie de conséquence de l'inclusion dans son assiette de
l'indemnité de "difficultés particulières".
2
• Je passe sur les décisions qui ont été rendues en première
instance par les Conseils de Prud'hommes et m'en tiendrai aux arrêts des Cours
d'appel.
C'est
la Cour d'appel de Metz qui a statué la première, par un arrêt du 26 février
1991, en faisant droit aux demandes des salariés. La Cour de Metz a estimé
qu'en présence des stipulations parfaitement claires de l'accord du 28 mars
1953, ne nécessitant aucune interprétation, l'indemnité de "difficultés
particulières" devait être calculée sur la base de 12 points, lesquels
ne pouvaient être que les points résultant de l'actuelle convention
collective.
Cet
arrêt, ou plutôt les 25 arrêts identiques ont été frappés de pourvois par
le préfet et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; ils
ont été cassés par la Cour de cassation le 22 avril 1992. Selon la Cour de
cassation, qui consacrait ainsi la position des caisses, le changement de
classification intervenu en 1963, puis à nouveau en 1974, avait entraîné la
disparition de l'indice de référence de l'accord de 1953. La Cour de cassation
estimait que devant cette disparition de l'indice de référence, les juges du
fond ne pouvaient retenir le nouvel indice, auquel l'accord de 1953 ne se référait
pas ; la Cour de cassation indiquait par conséquent la démarche à suivre par
les juges du fond : il leur appartenait de rechercher si un usage s'était créé
sur un nouveau mode de calcul de l'indemnité et, à défaut d'un usage, de déterminer
quel aurait été, à la date de chaque échéance de la prime, le taux
qu'aurait atteint l'indice de référence s'il avait été maintenu.
Autrement
dit, la Cour de cassation prescrivait aux juges du fond une double recherche :
d'abord celle d'un usage, et si cette recherche s'avérait négative, la
reconstitution de l'indice de référence initial, ce qui obligeait les juges du
fond à imaginer ce qu'il aurait pu être s'il n'avait pas été supprimé.
Il
faut convenir que cette deuxième partie de la recherche invitait les juges du
fond à un exercice assez acrobatique : que serait devenu l'indice s'il n'avait
pas été supprimé ? La première recherche, portant sur l'usage, était plus
classique, même si elle ne mettait pas les juridictions à l'abri de recherches
hypothétiques.
Quoi
qu'il en soit, la Cour de cassation condamnait clairement la thèse des salariés
demandant une indemnité égale à 12 fois la valeur du nouvel indice.
Après
cet arrêt de cassation, trois Cours d'appel ont eu à se prononcer sur la même
question.
Tout
d'abord, la Cour de Colmar, qui avait été saisie comme la Cour de Metz de différents
recours sur la question, a rendu ses arrêts le 23 septembre 1993, en
suivant les directives qui résultaient des arrêts de la Cour de cassation du
22 avril 1992. S'arrêtant à la première recherche demandée, c'est-à-dire
celle d'un usage, la Cour de Colmar a estimé qu'un usage s'était créé pour
calculer l'indemnité à 3,95 fois la valeur du point depuis l'avenant du 17 avril
1974. L'arrêt de Colmar repose sur une motivation du plus solide bon sens et de
la plus grande exactitude juridique : l'avenant du 10 juin 1963 n'avait pas eu
pour objet ni pour effet d'entraîner une augmentation des rémunérations, mais
seulement une augmentation de la valeur du point en raison de la modification de
la grille indiciaire ; le maintien du coefficient multiplicateur initial aurait
eu pour conséquence de bouleverser l'équilibre et la portée du protocole,
puisqu'il aurait entraîné un relèvement imprévu et très important de
l'indemnité sans augmentation corrélative des salaires ; la réduction du
coefficient multiplicateur n'a pas porté atteinte aux droits acquis des salariés,
puisque le montant de la prime est resté inchangé. Et la Cour de Colmar
conclut : il s'est ainsi créé une pratique constante et librement observée,
c'est-à-dire un usage qui a été reconduit après l'entrée en vigueur de
l'avenant du 17 avril 1974...
La
Cour d'appel de Metz, saisie d'une seconde série de litiges, a statué par différents
arrêts d'avril à septembre 1993, maintenant sa position initiale et refusant
de s'incliner devant la doctrine de la Cour de cassation. Elle a donc considéré
que le versement de l'indemnité devait être effectué sur la base de 12
points.
Enfin
la Cour d'appel de Besançon, désignée comme juridiction de renvoi après la
cassation des premiers arrêts de la Cour d'appel de Metz, a consacré une
troisième solution par un arrêt du 13 octobre 1993. Se plaçant dans le
sillage de l'arrêt de cassation, elle recherche d'abord si un usage avait été
créé, mais contrairement à la Cour de Colmar, elle répond par la négative.
Elle se trouve alors conduite à effectuer la deuxième recherche, indiquée à
titre subsidiaire par les arrêts de la Chambre sociale : elle recherche, à défaut
d'usage, quelle aurait été la valeur du point d'indice telle que prévue dans
la convention collective de 1946, si celle-ci n'avait pas été modifiée. Et
elle en conclut que l'indemnité doit être calculée sur la base de 6,1055 du
Salaire Minimum Professionnel Garanti. Mais on doit tout de suite relever que
cette solution est directement contraire à la doctrine de l'arrêt de
cassation, à laquelle la Cour de Besançon rend un respect de pure forme, car
sous couvert de créer un "indice de raccordement", elle crée
de toutes pièces un nouveau mode de calcul de l'indemnité qui n'a même plus
pour base la valeur du point de la convention collective. L'arrêt de Besançon
créait donc une nouvelle indemnité qui ne se rattachait ni à l'arrêt de
cassation ni au protocole de 1953.
3
• Bien entendu, tous ces arrêts ont été frappés de pourvois et
c'est alors que le législateur est intervenu pour dicter à la Cour
de cassation la solution qui selon lui s'imposait. La divergence de
jurisprudences des juridictions du fond était certes réelle, mais ce n'était
pas la première ni la dernière, et c'est précisément pour y mettre de
l'ordre que la Cour de cassation a été instituée. A mon avis, si l'on avait
laissé les procédures suivre leur cours normal, la solution retenue par la
Cour de Colmar, fondée sur une pratique constante de vingt-cinq ans, caractéristique
d'un usage, aurait dû être entérinée. La seconde série d'arrêts de la Cour
de Metz, identique à la première, aurait dû elle aussi être cassée. Et
enfin, les arrêts de la Cour de Besançon, fixant de nouvelles modalités de
calcul de l'indemnité sans rapport avec le protocole fondateur de 1953, aurait
dû lui aussi être cassé. En définitive, le jeu normal du pourvoi aurait pu
conduire à maintenir la pratique qui avait consisté à calculé l'indemnité
sur la base du coefficient de 3,95. Telle est la solution qui aurait sans doute
été finalement retenue si on avait laissé les procédures suivre leur cours
et la Cour de cassation exercer son rôle de juge régulateur.
Le
législateur en a toutefois décidé autrement et a préféré dicter la
solution à la Cour de cassation par voie autoritaire, ce qui vaut à la France
une condamnation à Strasbourg, et qui permet aux salariés, qui réclamaient à
l'origine des sommes comprises entre 40 et 50.000 francs et dont la demande
aurait probablement échoué, d'obtenir finalement 80.000 francs !
4
• En effet, dans le cadre d'une loi concernant la santé publique et la
protection sociale, le gouvernement a pris l'initiative de présenter un
amendement, qui devint l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994.
Cet
article 85 prévoyait que, sous réserve des décisions de justice devenues définitives,
le montant de l'indemnité de "difficultés particulières" institué
par le protocole d'accord du 28 mars 1953, nonobstant toutes stipulations
collectives et individuelles contraires, serait fixé, à compter du 1er
décembre 1983, à 3,95 fois la valeur du point résultant des accords
salariaux.
Autrement
dit, le législateur entérine la pratique constante suivie par les caisses
depuis la disparition de l'indice, pratique elle-même entérinée par la Cour
de Colmar et qui avait toutes chances d'être entérinée à son tour par la
Cour de cassation.
Le
Conseil constitutionnel fut saisi, mais il estima que l'article 85 n'était pas
contraire à la Constitution puisqu'il réservait les décisions de justice définitives.
Le Conseil constitutionnel rappelait également sa position selon laquelle il
est loisible au législateur "de prendre des dispositions rétroactives
afin de régler pour des raisons d'intérêt général les situations nées des
divergences de jurisprudences ci-dessus évoquées...".
Ainsi,
s'appuyant sur ce texte législatif nouveau et rétroactif, la Cour de cassation
devait casser sans renvoi les arrêts de Besançon et de Metz et rejeter les
pourvois dirigés contre les arrêts de Colmar. Les salariés étaient ainsi déboutés
de leur demande de complément d'indemnité.
5
• C'est en cet état que les salariés ont saisi la Commission européenne
des droits de l'Homme en faisant valoir une double violation de l'article 6,
paragraphe 1 de la Convention :
- tout
d'abord, l'intervention du législateur pour imposer la solution de pourvois en
cours caractériserait une méconnaissance du caractère équitable du procès ;
- ensuite,
la longueur de la procédure serait incompatible avec le délai raisonnable.
Je
passe rapidement sur ce dernier aspect du litige. La Commission, puis la Cour,
ont estimé que le délai raisonnable avait été dépassé à l'égard de
certains des requérants. La solution me paraît discutable et de faible intérêt.
L'intérêt
de l'arrêt se trouve dans les limites apportées par la Cour au pouvoir des
Etats d'édicter des règles rétroactives. L'arrêt du 28 octobre 1998 énonce
à ce sujet des règles qui me paraissent justes si on les retient de façon
abstraite. Je suis en revanche beaucoup moins convaincu par l'application qui en
est faite en l'espèce.
J'ai
l'impression que la Cour a voulu sanctionner par principe toute intervention législative
dans un procès en cours, beaucoup plus que l'atteinte effective que cette
intervention aurait causée aux droits des requérants.
6
• Indépendamment de la motivation donnée pour condamner la France, la
Cour devait écarter en quelques mots l'objection tirée de ce que le Conseil
constitutionnel, dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité, n'avait
formulé aucune objection à la rétroactivité de la loi en cause dès lors que
celle-ci avait été prise pour des motifs d'intérêt général, qu'elle
respectait les décisions judiciaires irrévocables, et qu'elle n'avait pas de
caractère pénal. Le gouvernement français avait longuement fait valoir dans
son mémoire que cette décision du Conseil constitutionnel confirmait la légitimité
de la démarche du législateur non seulement à l'égard de la Constitution
française, mais également au regard de la Convention européenne de droits de
l'Homme, puisqu'elle avait été prise "à l'aune de critères très
comparables à ceux dégagés par la jurisprudence de la Cour".
A
quoi la Cour a répondu par un motif lapidaire qu'elle "estime que la décision
du Conseil constitutionnel ne suffit pas à établir la conformité de l'article
85 de la loi du 18 janvier 1994 avec les dispositions de la Convention" (§ 59).
La Cour européenne ne s'estime donc pas liée par la décision du Conseil
constitutionnel. L'arrêt exprime donc davantage l'indépendance des deux
institutions, plutôt qu'une censure de la Cour à l'égard du Conseil (comp. P. Tavernier,
JDI, 2000, p. 131). La Cour exerce son contrôle par référence à la
seule Convention et à l'interprétation qu'elle en donne, alors que le Conseil
constitutionnel exerce son contrôle de la loi par référence à la seule
Constitution, et non aux traités internationaux (ce qui aboutit au paradoxe
qu'une loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel
peut néanmoins être écartée par le juge judiciaire ou administratif comme
contraire à un traité international). Ce point étant acquis, il est exact que
si, comme le soutenait le gouvernement français, le Conseil constitutionnel a
voulu se rapprocher de la Cour dans la détermination des conditions auxquelles
doit satisfaire une loi rétroactive, force est de constater que la Cour a marqué
sa distance et donc sa réprobation à l'égard des critères retenus en l'espèce
par le Conseil constitutionnel.
7
• Sur le fond, la Cour réaffirme les règles résultant de sa
jurisprudence antérieure, auxquelles on ne peut que souscrire. Elle réénonce,
au paragraphe 57 : "Si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché
de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive,
des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du
droit et la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 s'opposent,
sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir
législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement
judiciaire du litige".
Et
la Cour se réfère à ses arrêts antérieurs : Raffineries Grecques Stran
et Stratis Andreadis, 9 décembre 1994 ; Papageorgiou, 22
octobre 1997 ; National & Provincial Building Society, 23
octobre 1997.
La
Cour européenne stigmatise les dispositions de l'article 85 : même si elles
excluent les décisions de justice devenues définitives, elles fixent définitivement
les termes du débat soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire, et ce de
manière rétroactive, nonobstant toutes stipulations collectives ou
individuelles contraires. La Cour rapproche la date de la loi de celle de l'arrêt
de Besançon prononcé quelques mois auparavant, pour en déduire qu'il n'y a
aucun doute sur la volonté du législateur d'intervenir sur la solution de
litiges en cours.
La
Cour relève encore que la solution imposée par la loi était parfaitement
conforme aux demandes présentées par le représentant de l'Etat dans le cadre
des procédures pendantes. La Cour note que les juridictions du fond étaient
majoritairement favorables aux requérants (Metz, et dans une moindre mesure,
Besançon). La loi avait donc clairement pour objet et a bien eu pour effet
d'imposer aux juridictions judiciaires, et plus particulièrement à la Cour de
cassation, la position préconisée par l'Etat.
La
Cour enfin écarte diverses objections du gouvernement. Pour l'essentiel, le
gouvernement entendait justifier l'intervention législative par les divergences
de jurisprudences. La Cour relève tout d'abord que de telles divergences
constituent par nature la conséquence inhérente à tout système judiciaire décentralisé,
surtout lorsque, comme en l'espèce, ce système judiciaire distingue entre les
juridictions du fond qui jugent à la fois en fait et en droit, et la Cour de
cassation qui ne juge qu'en droit. A partir du moment où on admet la légitimité
d'un tel système, il faut en admettre la conséquence inévitable, qui est
qu'une même situation puisse être appréciée différemment par des
juridictions différentes.
Quant
aux contradictions de droit, la Cour de cassation était précisément instituée
pour les prévenir et y remédier. Et rien ne permet de dire que ce rôle régulateur
n'aurait pas pu être assuré en l'espèce. Toutes les raisons avancées par la
Cour européenne pour condamner l'intervention législative dans un procès en
cours me paraissent excellentes. Le gouvernement français avançait bien les
conséquences financières calamiteuses de la jurisprudence des juridictions du
fond qu'il combattait ; mais il n'a avancé aucune précision à ce sujet, se
bornant à lancer le chiffre de 350 millions, sans dire s'il s'agissait du coût
annuel, mensuel ou autre. Pour l'essentiel, l'argumentation du gouvernement
devant la Cour consistait à exagérer les conséquences de la divergence
constatée entre les jurisprudences des cours d'appel de Metz, Colmar et Besançon.
Mais ce constat ne pouvait en aucun cas servir de justification d'une
intervention législative. Le gouvernement n'avançait aucune raison pour dépouiller
à l'avance la Cour de cassation de ses pouvoirs sur les litiges en cours qui ne
se réduisaient pas à des questions de fait. A quoi servirait la Cour de
cassation si le législateur se croyait tenu d'intervenir chaque fois qu'une
divergence est constatée entre les juridictions du fond. C'est précisément le
rôle de la Cour de cassation d'unifier l'interprétation du droit. Et à mon
avis, comme je l'ai déjà indiqué, les décisions des juridictions du fond n'échappaient
pas à tout contrôle de la Cour de cassation. Celle-ci en effet ne se borne pas
à énoncer des règles purement abstraites, comme le fait le législateur. La
Cour de cassation, par le biais du contrôle de manque de base légale, qui a précisément
été exercé dans cette affaire, impose aux juges du fond de constater les éléments
de fait qui donnent une justification légale à la solution retenue. Rien, à
priori, ne laissait craindre que la Chambre sociale laisserait s'instituer le
chaos. Il aurait fallu au moins laisser les procédures suivre leur cours normal
; et l'intervention législative n'aurait pu être justifiée que si elle avait
été le seul remède possible à un chaos réellement établi.
Contrairement
à ce qui a pu être écrit dans les mémoires présentés devant la Cour européenne,
l'usage ne se réduit pas, ou du moins pas toujours, à une question de pur fait
appréciée souverainement par les juges du fond. Lorsque l'on est en présence
d'une pratique constante suivie sans contestation pendant près de trente ans,
il n'en résulte pas nécessairement une présomption irréfragable de
consentement. Mais il y a quand même une présomption forte qui ne peut être
combattue que par des éléments sérieux prouvant la volonté contraire. Dans
la présente espèce, la Cour de Metz avait déclaré que le changement de
valeur de l'indice n'impliquait pas l'acceptation de la modification du
coefficient. Cette appréciation n'a pas échappé à la censure : la Chambre
sociale a cassé les arrêts de Metz pour n'avoir pas recherché les usages qui
avaient pu s'instaurer, usages qui, dans la meilleure tradition civiliste,
valent présomption de volonté. La présomption n'est pas irréfragable. Mais
pour décider contre l'usage, les juges du fond doivent relever les éléments
qui caractérisent la volonté contraire. Et aucune des trois Cours d'appel
saisies n'avait relevé de tels éléments.
L'intervention
législative était donc parfaitement injustifiée car la Cour de cassation
aurait très bien pu mettre fin à la divergence de jurisprudences par
l'exercice normal de son contrôle et de sa mission.
8
• Mais cette intervention législative, condamnable par principe,
caractérisait-elle à l'égard des salariés une atteinte effective aux droits
garantis par la Convention ? Ce n'est pas évident.
Tout
d'abord, si on se réfère au motif de principe avancé par l'arrêt, la Cour
européenne condamne la loi qui vise à influer sur le dénouement du litige. Ce
principe aurait dû conduire à rechercher l'influence, c'est-à-dire le rôle
causal qu'avait eu la loi sur la solution du litige. En d'autres termes, il ne
peut y avoir violation de la Convention que si l'intervention législative avait
eu réellement pour effet de changer la solution qui, en son absence, serait résultée
du cours normal de la justice.
Aussi
le gouvernement français opposait-il, à juste titre à mon avis, que la loi
n'avait probablement rien changé. Et en ce sens il disposait d'un argument de
poids : la Cour de cassation avait déjà statué en cassant, avant
l'intervention législative, l'arrêt de la Cour d'appel de Metz qui avait
accueilli les demandes. Devant cette objection, la Cour européenne fait une
curieuse marche arrière : on ne saurait dit-elle, préjuger de ce que la Cour
de cassation aurait décidé sans l'intervention de la loi. La Cour européenne
refuse donc expressément de rechercher si la loi a changé effectivement le
cours normal de la justice. La violation de l'article 6 résulte, selon la Cour,
du seul fait que le législateur a voulu imposer la solution des litiges en
cours, peu important que cette solution ait été celle-là même qui était
annoncée, sinon déjà donnée par un arrêt antérieur de la Cour de
cassation.
Ensuite,
le gouvernement avait encore fait valoir que l'intervention législative se
justifiait par son objet particulier, qui était de colmater "une faille
d'ordre technique", tardivement découverte dans les accords collectifs qui
avaient oublié de traiter de leur incidence sur l'indemnité de difficulté
particulière. Le gouvernement français soulignait qu'il n'y avait pas eu
atteinte aux droits acquis, non plus qu'aux prévisions raisonnables des
parties, puisque l'application de la loi n'aboutissait qu'au maintien de la
valeur de l'indemnité litigieuse et à la confirmation d'un usage déjà
instauré. Puisque la loi ne faisait que maintenir ce qui avait été fait
depuis vingt-cinq ans, aucun salarié ne pouvait raisonnablement espérer une
telle revalorisation, qui serait tombée comme un effet d'aubaine, et qui était
le fruit de l'imagination astucieuse des exégètes plutôt que de la commune
volonté des auteurs des accords collectifs. La loi avait tout au plus déjoué
un pari, mais certainement pas une attente légitime. L'équité de la procédure
n'interdisait donc pas nécessairement dans ces circonstances une loi rétroactive.
L'arrêt
du 28 octobre 1999 ne répond pas à cette objection. On peut donc y voir un
revirement important de la Cour qui avait admis auparavant une rétroactivité
limitée ayant pour objet la correction d'imperfections techniques du droit antérieur
(National and Provincial Building Society, 23 octobre 1997).
Enfin,
sur la réparation pécuniaire accordée au requérant, l'arrêt du 28 octobre
1999 se montre généreux. C'est le moins qu'on puisse dire. On admettra sans
peine que la Convention européenne des droits de l'Homme ne garantit pas aux
employés des caisses de sécurité sociale d'Alsace-Moselle une indemnité de
difficulté particulière égale à douze fois le point d'indice.
La
Cour dit dans son arrêt qu'elle ne sait pas et ne veut pas savoir ce que les
salariés auraient reçu en définitive si les procès avaient suivi leur cours
normal. Elle ne veut pas non plus tenir compte de ce que les demandes des salariés
étaient sérieusement compromises après la cassation des arrêts de Metz,
avant même la loi de 1994. Mais appréciant la réparation de la seule atteinte
formelle à l'équité de la procédure, la Cour accorde aux salariés plus que
ce qu'ils avaient demandé devant les juridictions françaises au seul titre de
l'indemnité. En effet, le montant de l'indemnité demandée devant les Conseils
de Prud'hommes étaient, selon les salariés, de 40.000 à 50.000 francs. A quoi
s'ajoutaient des intérêts de retard de l'ordre de 15.000 francs. Les demandes
variaient donc, au total, entre 55.000 et 65.000 francs.
La
Cour européenne a toutefois considéré qu'au seul titre du préjudice moral résultant
de la violation de l'article 6, chaque salarié devait recevoir une somme de
80.000 francs.
La
Cour a également été généreuse sur les frais de procédure en accordant à
l'ensemble des requérants diverses sommes s'élevant au total à 96.000 francs.
Jean-Paul
COSTA
Dans
le débat, je pense qu’on ne discutera pas des frais et dépens, et de la générosité
de la Cour de Strasbourg vis-à-vis des avocats comparée à la ladrerie des
juridictions nationales. Sur le fond, vous avez réussi à nous faire un exposé
vivant et très complet d’une affaire qui était pourtant complexe et qui
effectivement soulève de nombreux problèmes. Je dirai simplement, et j’y
reviendrai dans le débat, que le mérite principal de cet arrêt, et je peux le
juger de l’extérieur, c’est d’avoir clarifié la notion de possibilité
d’intervention du législateur au titre des lois de validation car il y avait
eu des arrêts de la Cour : les Raffineries grecques, les affaires anglaises, où
cela n’était pas très clair. La Cour s’est exprimée dans cette affaire de
façon assez nette.
Nous
allons maintenant entendre l’exposé de Mme Dubrocard, bien connue également
du CREDHO, qui est sous-directeur des droits de l’Homme à la Direction des
affaires juridiques des Affaires étrangères et qui, à ce titre, vient fréquemment
plaider pour le gouvernement français devant la Cour. J’ai souvent le plaisir
de voir Mme Dubrocard d’un côté à l’autre de la barre, mais ici nous
sommes à la même table... Elle va nous parler d’un arrêt qui a fait couler
beaucoup d’encre et en fera encore couler sans doute beaucoup, c’est
l’affaire Selmouni.
•
Requalification des faits en matière pénale :
l’affaire
Pélissier et Sassi (arrêt du 25 mars 1999)
par
Dominique
ALLIX
Professeur
à l’Université de Paris-Sud
1.
Dans cette affaire née d'un banal dépôt de bilan, plus de cinq ans auront été
nécessaires pour constater que les prévenus ne pouvaient être légalement
poursuivis comme auteurs du délit qui leur était reproché, plus de sept ans
pour découvrir qu'ils s'étaient rendus complices de ce même délit, et plus
de quatorze ans pour constater qu' ils ne s'étaient pas vu offrir l'occasion
d'organiser leur défense au regard de cette nouvelle qualification et qu'une
atteinte avait été portée au droit qu'ils avaient d'être informés d'une
manière détaillée de la nature et de la cause portée contre eux, ainsi qu'à
leur droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de leur défense.
Plus
concrètement : définitivement condamnés pour complicité de banqueroute par détournement
d'actif à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30000F d'amende, les requérants
se voit allouer, cinq ans plus tard par la Cour, les sommes de 90000F pour
dommage matériel et moral et celles de 70000F pour frais et dépens.
2.
Un Etat de droit peut-il s'accommoder de cette justice à rebours ? Il est
permis d'en douter : une tête coupée ne repousse pas !
La
défaillance de nos institutions répressives est en réalité patente, qu'il
s'agisse des moyens mis en œuvre pour garantir la célérité des procédures
ou du contrôle exercé par la Cour de cassation sur le respect des droits de la
défense, notion décidément bien mal assimilée par la Chambre criminelle.
La
Cour de Strasbourg ne nous délivre pas de l'injustice, elle nous confronte à
l'injustice.
3.
Le 27 juin 1990, au terme d'une information ouverte en 1983 à la suite du dépôt
de bilan de la SARL Bleu marine, société dans laquelle ils étaient associés
chacun pour 250 parts sur un total de 1000 parts, MM. Sassi et Pélissier étaient
renvoyés devant le tribunal correctionnel de Toulon du chef de banqueroute par
détournement d'actif sur le fondement des articles 196 et 197 de la loi du 25
janvier 1985, délit puni par l'article 402 du Code pénal.
4.
Cependant, par jugement du 12 mars 1991, le tribunal constatait qu'aux termes de
la loi, seules les personnes ayant dirigé, directement ou indirectement, en
fait ou en droit, la société étaient punissables et que faute de pouvoir être
pertinemment qualifiés de gérants de droit ou de fait de la société Bleu
marine, les prévenus Sassi et Pélissier n'avaient pu se rendre coupable du délit
qui leur était reproché et qu'ils devaient donc être relaxés.
5.
Les parties civiles et le ministère public ayant interjeté appel de cette décision,
la Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmait que prévenus de banqueroute, mais
n'étant pas gérants de droit ou de fait de la société Bleu Marine, MM. Sassi
et Pélissier n'avaient pu se rendre coupables, en tant qu'auteurs, du délit
qui leur était reproché.
Mais
considérant qu'ils avaient été informés des graves difficultés de la société
et qu'ils avaient accompli des actes matériels volontaires et positifs qui
avaient facilité, aidé ou assisté l'auteur principal du délit, c’est-à-dire
le gérant, dans le détournement d'actif commis au préjudice de la société
Bleu marine, la Cour d'appel décidait, en cours de délibéré, de requalifier
les faits en complicité de banqueroute par détournement d'actif et jugeait
utile de relever que l'un des prévenus, M.Pélissier , avait fourni une fausse
attestation pour justifier du versement d'une somme d'argent dans le cadre d'une
opération litigieuse.
6.
Condamnés pour complicité de banqueroute à 18 mois d'emprisonnement avec
sursis et 30000F d'amende, MM. Sassi et Pélissier décidaient de se pourvoir en
cassation contre cette décision. Pourvoi à l'appui duquel ils firent valoir,
en invoquant l'article 6 de la Convention, que la requalification opérée par
la Cour d'appel n'avait pas été contradictoirement débattue et portait
atteinte aux droits de la défense, M.Pélissier ajoutant qu'en faisant état de
prétendues manipulations par lui effectuées sur son compte au moyen d'une
fausse attestation, la Cour d'appel avait utilisé des faits qui ne lui avaient
jamais été reprochés et qui, étrangers à la poursuite, ne pouvaient lui être
opposés.
Mais,
par arrêt du 14 février 1994, la Cour de cassation rejetait ce pourvoi au
motif - clause de style - que " les énonciations de l'arrêt attaqué la
mettaient en mesure de s'assurer que les juges du fond avaient caractérisé
sans insuffisance, et dans la limite de leur saisine, en tous leurs éléments
constitutifs, matériels et intentionnels tant le délit principal de
banqueroute par détournement d'actif imputé à son auteur, que la complicité
du délit de banqueroute par détournement d'actif retenu à la charge de MM.
Sassi et Pélissier", et que - autre clause de style - " les moyens
qui se bornaient à remettre en question l'appréciation souveraine par les
juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus
devant eux, ne pouvaient être admis".
7.
Estimant, d'une part, que leur droit à un procès équitable n'avait pas été
respecté, tant en raison de la requalification pénale des faits que de
l'utilisation par la Cour d'appel d'un document (fausse attestation ayant servi
à des manipulations comptables) qui ne figurait pas au nombre des faits visés
par l'ordonnance de renvoi, et dénonçant, d'autre part, la durée excessive de
la procédure pénale suivie à leur encontre, MM. Sassi et Pélissier ont saisi
la Commission dont l'avis, rendu à l'unanimité, fut qu'il y avait eu violation
de l'article 6 par. 1 et 3 a) et b) quant aux atteintes portées à l'équité
de la procédure par la requalification des faits, et de l'article 6 par. 1
quant à la durée de la procédure.
Saisie
par le gouvernement et par la Commission, la Cour (grande chambre) a conclu, à
l'unanimité, qu'il y avait bien eu violation de l'article 6 par. 1 et 3 a) et
b) quant aux atteintes portées à l'équité de la procédure par la
requalification des faits et de l'article 6 par. 1 quant la durée de la procédure.
I
• Sur l’équité de la procédure
8.
A • La Cour examine tout d'abord, pour l'écarter comme l'avait fait la
Commission, le grief tiré de l'utilisation par la Cour d'appel du document
qualifié de fausse attestation qui n'aurait pas été visé dans l'ordonnance
de renvoi.
9.
Rappelant que la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant
que tel, qu'elle ne saurait exclure par principe et in abstracto
l'admissibilité d'une preuve recueillie sans respecter les prescriptions du
droit national et qu'il revient aux juridictions internes d'apprécier les éléments
obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la
production, la Cour se borne conformément à sa jurisprudence habituelle
à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière
dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu
par l'article 6 par. 1, étant précisé que l'équité d'une procédure s'apprécie
au regard de l'ensemble de celle-ci.
10.
Considérant alors - au vu de l'ensemble des éléments en sa possession, mais
on ignore lesquels - que le document litigieux et son utilisation par la Cour
d'appel n'avaient pas été déterminants pour la déclaration de culpabilité
et la condamnation du prévenu concerné, la Cour en déduit que la prise en
compte du document contesté n'a pas eu pour effet de porter atteinte à l'équité
de la procédure et qu'elle n'était donc pas de nature à entraîner une
violation de l'article 6 par.. 1 de la Convention.
Ce
faisant la Cour entérine la thèse du gouvernement et se range à l'avis de la
Commission qui avait jugé ce grief factuel et accessoire.
11.
Bien qu'elle soit apparemment conforme à la jurisprudence de la Cour, cette décision
conduit tout de même à s'interroger sur les limites du pouvoir de contrôle de
la Cour. En affirmant que le document litigieux et son utilisation par la Cour
d'appel n'ont pas été déterminants pour la déclaration de culpabilité du prévenu
et sa condamnation, la Cour se prononce sur la pertinence des éléments de
preuve retenus par les juges du fond et n'hésite pas à substituer sa propre
vision des faits à celle de la Cour d'appel qui, bien qu'elle ne fut aucunement
tenue d'entrer dans le détail des conclusions dont elle était saisie, avait
jugé utile, sinon nécessaire, de mentionner et de retenir comme élément de
preuve à charge de la complicité l'existence du document litigieux.
12.
B • La Cour examine ensuite le grief concernant la requalification des
faits par la Cour d'appel, une requalification dont les requérants n'ont jamais
contesté le principe mais seulement les conditions dans lesquelles elle était
intervenue en cours de procès.
13.
Rappelant que l'article 6 par. 3 a) de la Convention reconnaît à l'accusé le
droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c’est-à-dire
des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde
l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et
ce de manière détaillée,
la Cour relève que la portée de cette disposition doit notamment s'apprécier
à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le
paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention
et juge opportun de souligner qu'en matière pénale, une information précise
et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification
juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition
essentielle de l'équité de la procédure.
14.
Ce faisant la Cour admet que les dispositions de l'article 6 par. 3 n'imposent
aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé
de la nature et de la cause de l'accusation, mais elle précise qu'il existe un
lien entre les alinéas a) et b) de l'article 6 par. 3 et que le droit à être
informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la
lumière du droit pour l'accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires
pour préparer sa défense.
15.
Examinant alors les données circonstancielles de la cause, la Cour constate :
-
que l'information conduite par le juge d'instruction ne concernait à l'évidence
que les seuls faits de banqueroute, aucun élément ne permettant de penser que
la possibilité d'une complicité de banqueroute ait été réellement prise en
compte au cours de l'instruction, ni même lors de l'inculpation ;
-
que les débats devant le tribunal correctionnel n'avait porté que sur le délit
de banqueroute, les termes du jugement rendu par le tribunal confirmant
l'absence de la notion de complicité des débats judiciaires ;
-
que renvoyés devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à la suite de l'appel
interjeté par le ministère public, les requérants ne s'étaient à aucun
moment vu reprocher de la part des autorités judiciaires une éventuelle
complicité de banqueroute que ce soit dans la citation à comparaître ou au
cours des débats
-
que rien n'indique que les conclusions additionnelles de la partie civile évoquant
une éventuelle complicité de banqueroute avaient été communiquées aux requérants
ou à leurs conseils, leur simple dépôt au greffe ne pouvant suffire au
respect des dispositions du paragraphe 3 a) de l'article 6 de la Convention.
16.
Ainsi, considérant au vu de ces éléments que les requérants n'avaient pas eu
connaissance de ce qu'il était possible que les faits qui leur étaient reprochés
soient requalifiés par la Cour d'appel en complicité de banqueroute, et
"compte tenu de la nécessité de mettre un soin extrême à notifier
l'accusation à l'intéressé" et "du rôle déterminant joué par
l'acte d'accusation dans les poursuites pénales", la Cour estime qu'aucun
des arguments avancés par le gouvernement pris ensemble ou isolément
ne pouvait suffire à garantir le respect des dispositions de l'article 6 par. 3
a) de la Convention.
17.
Quant à savoir si la notion de complicité en droit français n'impliquait pas,
de la part des requérants, une connaissance suffisante de la possibilité de
requalification du délit de banqueroute en complicité de banqueroute, la Cour
constate que la complicité ne pouvait se trouver établie qu'avec la réunion
d'un certain nombre d'éléments ,spécifiques.
Ainsi
déclarant ne pouvoir suivre le gouvernement lorsqu'il soutient que la complicité
ne constitue qu'un simple degré de participation à l'infraction principale,
les textes en disposant autrement et distinguant clairement auteur et complice,
la Cour relève qu'accusés de complicité les prévenus auraient dû convaincre
leurs juges qu'ils n'avaient, d'une part, commis aucun des actes de complicité
prévus par la loi et que, d'autre part, si des actes spécifiques à la
complicité leur étaient reprochés, ils n'avaient pas eu conscience d'aider à
la commission de l'infraction.
18.
Ajoutant à cela que la complicité ne constituait pas un élément intrinsèque
de l'accusation initiale que les intéressés auraient connu depuis le début de
la procédure
et constatant qu'à aucun moment les requérants ne s'étaient vu offrir
l'occasion d'organiser leur défense au regard de la nouvelle qualification,
puisque seul l'arrêt de la Cour d'appel leur avait permis de connaître ce
changement de qualification ce qui était à l'évidence tardif,
la Cour en déduit qu'une atteinte a été portée au droit des requérants à
être informés d'une manière détaillée de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre eux, ainsi qu’à leur droit à disposer du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense et conclut
qu'il y a eu violation du paragraphe 3 a) et 3 b) de l'article 6 de la
Convention, combiné avec le paragraphe 1 du même article qui prescrit une procédure
équitable.
19.
De cette décision, les processualistes
retiendront qu'elle ne remet pas en cause le droit qu'ont les juges de
requalifier les faits dont ils sont saisis pourvu que l'accusé soit pleinement
et officiellement informé par l'autorité compétente de la nature et de la
cause, c’est-à-dire de la base juridique et factuelle de l'accusation porté
contre lui, et qu'il puisse disposer du temps et des facilités nécessaires
pour préparer sa défense.
Exigences
qui pourraient un jour amener à s'interroger sur la théorie de la peine
justifiée, théorie suivant laquelle l'erreur dans la qualification sur
laquelle est fondée une condamnation pénale ne peut donner ouverture à
cassation lorsque la Cour de cassation constate -ce qui revient à requalifier
les faits- que la loi qui aurait dû être appliquée prononce la même peine.
II
• Sur la durée de la procédure
20.
Conformément à sa jurisprudence habituelle, la Cour précise la période à
prendre en considération avant de se prononcer sur le caractère raisonnable de
la durée de cette procédure.
21.
Ainsi, précisant que la période à considérer pour apprécier la durée de la
procédure au regard de l'exigence du délai raisonnable posée par l'article 6
par. 1 a commencé avec l'inculpation de MM. Pélissier et Sassi, à savoir
respectivement les 14 septembre 1984 et 12 juin 1985 et qu'elle s'est terminée
avec l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 février 1994, la Cour
constate que la procédure a duré neuf ans et cinq mois pour le premier requérant,
et huit ans huit mois et deux jours pour le second.
Restait
alors à se prononcer sur le caractère raisonnable de la durée de cette procédure
au regard des critères habituels, ce que fait la Cour en rappelant que la durée
d'une procédure s'apprécie suivant la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
22.
Compte tenu de ses constats quant à l'absence de complexité de l'affaire et au
comportement normal des requérants, la Cour relève qu'une instruction d'une
durée de plus de cinq ans ne se justifiait pas, que celle-ci avait connu des
retards et des périodes de latence injustifiés, qu'enfin la procédure de
jugement avait, elle-même, subi un retard injustifié entre l'appel interjeté
par le ministère public et la première audience tenue par la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence.
Ainsi,
constatant que la procédure faisait apparaître des retards excessifs
imputables aux autorités nationales, la Cour conclut qu'il y a eu dépassement
du délai raisonnable et violation de l'article 6 par. 1 quant à la durée de
la procédure, après avoir rappelé que l'article 6 par. 1 de la Convention
oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle
sorte que les cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, y
compris l'obligation de trancher les causes dans un délai raisonnable.
23.
Une conclusion qui ne mérite guère de commentaires, sinon pour souhaiter que
les Etats concernés, et notamment la France, prennent, enfin, en considération
cette donnée essentielle : "Souvent l'injustice n'est pas dans le
jugement, elle est dans les délais ".
Jean-Paul
COSTA
Je
remercie beaucoup le Professeur Allix qui avec science et brio, et en respectant
le délai raisonnable, a traité d'une affaire qui n'est peut-être pas la plus
difficile que la Cour ait eu à juger en 1999, mais qui est tout de même
importante.
Je
dirai, puisque je suis beaucoup moins spécialiste du droit pénal et de la procédure
pénale que l'orateur, qu'on aurait pu dire, en caricaturant, que la position du
gouvernement consistait à dire : qui peut le plus peut le moins, de quoi se
plaignent les requérants puisqu'être complices d'une banqueroute c'est moins
grave que d'être l'auteur d'une banqueroute ! Le principal mérite de l'arrêt,
vous l'avez dit, c'est sur le plan du respect des droits de la défense : ce
n'est pas du tout la même chose de savoir qu'on veut vous condamner pour
banqueroute, ou qu'on veut vous condamner pour complicité de banqueroute. Je ne
ferai pas un commentaire du commentaire.
Débats
Jean-Paul
COSTA
Je
voudrais faire deux brefs commentaires. Le premier pour dire que cette affaire Lemoine
est un peu l'illustration de ce que Paul Tavernier nous disait tout à l'heure
à propos des dispositions transitoires du Protocole n° 11, puisque dans le
fond comme la saisine de la Cour par le gouvernement a été considérée comme
tardive, c'est comme s'il n'y avait pas eu de saisine du tout, et comme vous
nous l'avez dit, c'est en réalité une décision de la Commission qui a été
ensuite suivie par le Comité des ministres. Cela laisse donc entier le problème
de la jurisprudence future de la Cour en cette matière, puisque ainsi que cela
arrive lorsqu'il n'y a pas de jurisprudence de la Cour, la Cour s'estime évidemment
non liée par la jurisprudence de la Commission, ni même par sa propre
jurisprudence d'ailleurs, mais elle aura donc à valider ou à infirmer la
position et le raisonnement juridique de la Commission.
Le
deuxième bref commentaire que je voudrais faire, mais cela empiète
probablement sur le débat sur l'affaire Chassagnou, c'est que dans les
dernières années, y compris au cours de l'année 1999, la Cour européenne des
droits de l'Homme a eu tendance à entendre plus largement la notion de respect
des biens ou la notion d'atteinte au droit de propriété, et le Protocole n°
1, article 1 donne lieu à plus d'arrêts que par le passé.
Paul
TAVERNIER
J’aimerais
faire une remarque dans le prolongement de celle qui vient d’être faite à
propos de l’affaire Lemoine. Apparemment, le gouvernement français ne
connaît pas les moyens modernes de communication et si le recours a été déclaré
irrecevable, c'est qu'il semble ignorer non seulement internet qui est vraiment
un instrument trop moderne, mais aussi le fax…
Jean-Paul
COSTA
Le
gouvernement français, je ne suis pas là pour le défendre, ne mérite ni cet
excès d'honneur, ni cette indignité... Je crois qu’il s’agit d’un
dysfonctionnement bureaucratique, et notamment, il n'est pas certain que notre
représentation permanente à Strasbourg n'ait pas fait une petite erreur de
transmission...C'est anecdotique... C'est vrai que d'une manière générale,
aussi bien pour le délai de trois mois qui existait dans cette hypothèse, que
sur le délai de six mois qui est le délai de droit commun, les parties, que ce
soit les requérants ou le gouvernement, ont la possibilité bien entendu de
recourir au fax, et cela se fait d'ailleurs de plus en plus souvent. C'est en réalité
confirmé ensuite par une lettre traditionnelle, mais le fax est considéré
depuis longtemps par la Commission et par la Cour comme ayant une valeur
certaine.
Antoine
BUCHET
C'est
moins une question qu'une remarque. Je voudrais rejoindre le professeur Allix
pour souligner l'importance de l'arrêt Pelissier et Sassi. Il est très
important. C'est une affaire sans doute un peu technique, mais à laquelle le
gouvernement était très attaché. Il avait d'ailleurs demandé et obtenu
qu'une audience soit organisée devant la Commission, au stade de la recevabilité
de l'affaire ; une seconde audience s'est ensuite tenue devant la Cour ; c'est
dire à quel point le gouvernement avait le sentiment d'avoir à traiter une
question très importante pour le travail quotidien des magistrats.
L'affaire
Pélissier & Sassi démontre en effet qu'il faut éviter, devant les
juridictions pénales, de donner au principe de la saisine in rem des
conséquences excessives. Le juge agit parfois à sa guise avec les éléments
de fait dont il est saisi, et, ce faisant, comme le remarque la Cour européenne
dans cet arrêt, il agit au détriment d'un certain nombre de droits, et
notamment du respect du contradictoire.
La
théorie de la peine justifiée est également épinglée par la Cour, car elle
permet de couvrir a posteriori un certain nombre d'inexactitudes juridiques qui
sont commises dans la conduite de la procédure et dans les décisions des juges
du fond. Tous ces excès de la saisine in rem, avec cette théorie de la
peine justifiée, sont maintenant bousculés par l'arrêt Pélissier &
Sassi et c'est pourquoi c'est un arrêt important.
En
matière civile, nul ne s'étonnerait de rouvrir les débats lorsqu'il y a une
nouvelle question qui se pose. Un juge civil n'oserait jamais, en cours de délibéré,
avoir une nouvelle idée sans la soumettre aux parties. En matière pénale,
alors que les enjeux pour les libertés individuelles sont nettement plus sérieux,
le juge se croit autorisé à plus de liberté. Je le dis avec d'autant plus de
franchise que, dans ma pratique de juge des enfants, j'ai également agi de la
sorte, en procédant à de nombreuses requalifications en cours de délibéré,
et je ne m'imaginais pas rouvrir les débats en demandant au prévenu mineur :
"Mais mon cher ami, nous étiez poursuivi comme coauteur, ne pensez-vous
pas que le fait de faire le guet est plutôt susceptible d'être qualifié de
complicité et non de coaction" ? Je n'ai jamais procédé de la sorte, et
j'avais tort.
S'agissant
des enjeux très juridiques de cette affaire, je tiens à préciser que le
gouvernement n'a pas voulu se contenter de dire : "qui peut le plus peut le
moins". C'est un raccourci qui ne reflète qu'imparfaitement la réalité.
Le gouvernement a simplement tenté de démontrer que lorsqu'il y a plusieurs
auteurs, ils sont tous complices entre eux. C'est ce que l'on appelle la théorie
de la complicité co-respective, consacrée par plusieurs arrêts de la chambre
criminelle. Il est vrai que nous avons cité beaucoup d'arrêts du XIXe siècle
devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Cela leur a paru peut-être un
peu poussiéreux ! Et nous avons ensuite retrouvé assez peu de traces de nos écrits
dans l'arrêt Pélissier & Sassi ni d'ailleurs dans rapport de la
Commission.
Un
dernier mot pour dire que le gouvernement, conscient de l'importance de cette décision,
adoptée à l'unanimité par les juges de la Cour, a décidé de procéder à sa
diffusion, non pas in extenso, mais sous la forme d'une note d'information,
adressée à toutes les juridictions. C'est une pratique désormais courante
pour les arrêts les plus importants : Fressoz et Roire, Selmouni,
etc. Pour l'arrêt Pélissier et Sassi, la note d'information a pour
objectif d'inviter tous les magistrats, aussi bien du siège que du parquet, à
être plus vigilants, notamment lors de l'audience qui doit permettre de traiter
ce type de questions.
Dans
cette affaire, le dossier ne contenait pas les notes d'audience ; nous ne
savions donc pas ce qui s'était passé pendant les débats devant la Cour
d'appel. Nous ignorions donc si le parquet avait requis ou non la
requalification des faits. La note diffusée par la Chancellerie convie ainsi
les magistrats à essayer de susciter ce débat autour de la qualification et de
la requalification lorsque précisément on a quelques doutes sur la décision
finale qui sera prise par la juridiction sur cette qualification.
Dominique
ALLIX
Je
voudrais apporter deux précisions. L’inculpation (la mise en examen) demeure
un acte fondamental puisqu’elle vaut accusation en matière pénale : on
notifie officiellement à l’intéressé les faits qui lui sont reprochés –
la cause de l’accusation – en même temps que la qualification susceptible
d’être retenue à son encontre – la nature de l’accusation. Or, si je me
réfère aux énonciations de l’arrêt, l’inculpation visait, je cite :
“ les textes relatifs tant à la banqueroute qu’à la complicité de
banqueroute ”. Un rapprochement s’impose avec l’affaire Salvador
Torres c. Espagne. Dans cette affaire, l’accusation initiale mentionnait,
mais sans viser le texte qui aurait permis de le qualifier, l’existence d’un
fait qui sera ultérieurement retenu comme circonstance aggravante lors du
jugement. Et la Cour a jugé qu’il s’agissait bien d’un élément intrinsèque
de l’accusation initiale.
Cela
ne vaut-il pas, mutatis mutandis, pour l’affaire Pélissier &
Sassi, affaire dans laquelle l’accusation ne qualifiait pas les faits,
mais visait les textes relatifs à la complicité de banqueroute ?
En
un mot, je me demande si la complicité de banqueroute, dès lors qu’étaient
visés les textes la qualifiant, n’était pas un élément intrinsèque de
l’accusation initiale.
Quant
à la règle “Tous les co-auteurs sont complices les uns des autres”,
longuement développée dans ma thèse de doctorat, aujourd’hui jugée poussiéreuse
parce que se référant à des nombreux arrêts du 19ème siècle, je
tiens à préciser qu’il s’agit d’une création qui n’a rien de
doctrinal, mais qui est purement prétorienne et dont la finalité, je l’ai démontré,
est purement répressive, mais dont la logique est imparable : “ Tous
les coauteurs sont complices les uns des autres parce qu’ils s’aident et
s’assistent réciproquement dans la perpétration des faits ”. Qui peut
le plus, peut le moins ; formule à l’emporte-pièce dont les juges de
Strasbourg ne sauraient se satisfaire. Dont acte.
Mais
ce qu’il importe de relever, c’est que cette règle ne pouvait être
utilement invoquée en l’espèce : n’ayant pu se rendre auteurs de
l’infraction qui leur était reprochée, MM. Sassi et Pélissier ne pouvaient
de toute évidence se voir opposer la règle selon laquelle “ tous les
coauteurs sont complices les uns des autres ”. A vouloir argumenter de la
sorte le gouvernement courait à un échec certain.
Jean-Paul
COSTA
Je
vais laisser Antoine Buchet répondre, mais je voudrais dire que je suis assez
proche du professeur Allix, parce que c'est précisément parce que la Cour
d'appel avait considéré qu'elle ne pouvait pas condamner MM. Pelissier et
Sassi pour banqueroute qu'elle a sorti de son chapeau cette histoire de
complicité de banqueroute... Personnellement, j'ai cru naïvement pendant un
moment alors que j'étudiais ce dossier, que dans le fond les droits de la défense
n'étaient pas bafoués parce que MM. Pelissier et Sassi auraient dû imaginer
qu'on pouvait leur reprocher cela. Or je ne le crois pas, et j'ai finalement
indiqué le principe bien connu suivant lequel seuls les imbéciles ne changent
pas d'avis, mais il m'arrive de ne pas changer d'avis !
En
ce qui concerne la question du professeur Allix, il nous a fait une citation
tronquée du paragraphe 55 de l'arrêt ! Je le cite intégralement : "La
Cour relève d'abord que dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel seul le délit de banqueroute est reproché au requérant. Bien
que l'inculpation supplétive des 4 et 16 décembre 1986 ait visé, au demeurant
sans motivation particulière, les textes relatifs tant à la banqueroute qu'à
la complicité de banqueroute, la Cour constate que l'information conduite par
le juge d'instruction concernait à l'évidence les seuls faits de
banqueroute". S’il y a une proposition subordonnée, il faut citer la
proposition principale ! C'est là le coeur de l'arrêt. C'est cela la question.
Dominique
ALLIX
C'est
ce que j'ai très précisément relevé. Mais je constate tout de même qu'il y
avait visa de texte dont le prévenu, ou son conseil, aurait pu tirer les conséquences
qui s’imposaient…
Jean-Paul
COSTA
Je
ne suis pas pénaliste, mais je pense que le visa d'un texte ce n'est pas la même
chose que de dire à quelqu'un on vous reproche 1- la banqueroute, 2- la
complicité de banqueroute...
Dominique
ALLIX
C'est
toute la différence avec l'arrêt Salvador Torres. Mais je persiste à
penser que la solution pouvait être appliquée mutatis mutandis dans
l’affaire Sassi et Pélissier.
Jean-Paul
COSTA
Mais
cet arrêt est plus rigoureux. J'assume l'arrêt Pelissier & Sassi,
je n'assume pas forcément l'arrêt Salvador Torres. La difficulté
principale était de savoir si les accusés, les requérants devant la Cour,
savaient ce qu'on leur reprochait ou pas... et c'était là que c'était en
effet un peu comme on dit en franglais, border-line. Qu'en pense Me
Delaporte ?
Vincent
DELAPORTE
Je
crois que je ne m'attacherai pas, pour définir l'étendue de la saisine,
uniquement à la numérotation, au visa des textes, parce qu'il y des erreurs de
frappe... et ce n'est pas un procédé d'information suffisant pour permettre,
à mon avis, l’exercice des droits de la défense. Le visa des textes est peu
probant. Ce qui compte, c'est le fait reproché, la qualification aussi, car
c'est en fonction de la qualification, même pour un non juriste, que l’accusé
comprend ce qu'on lui reproche et son Conseil organise normalement sa défense
à partir du fait précis reproché. Cela dit, l’avocat élargit généralement
un peu la thèse critiquée ; en demande ou en défense, on déborde un peu le
cas strict puisque précisément on sait que le juge aura quelque marge.
Il
n'en reste pas moins que je trouve tout à fait juste la décision de la Cour.
L’interdiction de requalification sans débat contradictoire est du reste de
faible portée, car la Cour ne dénie pas le pouvoir de requalification qui
appartient au juge ; la seule portée de l’arrêt est d'obliger le juge à
provoquer un débat contradictoire sur la nouvelle qualification envisagée.
Jean-Paul
COSTA
Merci
beaucoup de ce témoignage. Je rappelle d'ailleurs ce que vous nous avez dit
tout à l'heure : c'est que cette requalification a été opérée véritablement
in extremis puisque l'audience avait eu lieu, et non seulement il n'y a
pas eu de débat contradictoire, mais c'est en cours de délibéré, c'est-à-dire
au moment de la rédaction de l'arrêt que la Cour d'appel a opéré ce
changement de "pied" pour utiliser un terme de football, c'est plus
parlant dans mon esprit que la procédure pénale ! Je croyais avoir compris que
M. Allix était favorable à l'arrêt, mais il a des doutes...
Vincent
DELAPORTE
Cela
remet en cause une pratique quotidienne de la chambre criminelle : la peine
justifiée. Combien de fois on fait un pourvoi en fonction de la qualification,
en critiquant l'arrêt, au regard de la qualification retenue, et le pourvoi est
rejeté par la chambre criminelle qui apprécie la condamnation au regard d'une
autre qualification... La peine est justifiée. Il n'y a là aucun débat
contradictoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dominique
ALLIX
Peine
justifiée, sous le couvert de laquelle la chambre criminelle s'autorisait très
souvent à confondre auteurs, coauteurs et complices, en affirmant que cette
distinction était inopérante puisqu’ils encouraient la même peine. Nous
voilà donc revenus au point de départ.
Antoine
BUCHET
Même
si je suis convaincu par cet arrêt, deux aspects au moins me troublent. Nous étions
malgré tout persuadés que la notion de complicité était intrinsèquement
incluse en raison de cette théorie de la complicité co-respective tout
simplement parce que nous estimions qu'on ne pouvait pas apprécier cette théorie
uniquement après une déclaration de culpabilité. Je pense que ce que nous
avons essayé de démontrer, mais nous avons échoué, c'est qu'effectivement
les deux prévenus ne pouvaient pas "être totalement surpris" et découvrir
qu'ils pouvaient également être complices et que tous les actes retenus pour
les condamner au titre de la complicité ont été des actes discutés au cours
de l'instruction et au cours des débats. Cela ne fait aucun doute. Tous les
actes matériels retenus pour qualifier de complicité, in fine certes, avaient
été débattus. Mais il est vrai que la qualification ne l'a pas été, pas
suffisamment, en tout cas.
Je
me permets de souligner que ce n'est pas le gouvernement qui a prétendu que les
thèses qu'il défendait étaient " poussiéreuses ". J'ai eu le
sentiment, en revanche, que la Commission était de cet avis, et les thèses
remarquables, et les arrêts non moins remarquables, qui avaient été retenues
par la chambre criminelle sur cette notion de complicité et de co-action,
n'avaient peut être pas véritablement convaincu, certes, mais n'étaient pas véritablement
reflétées non plus dans le rapport de la Commission ni dans l'arrêt de la
Cour. Nous regrettons parfois que les thèses du gouvernement soient simplifiées,
mais c'est aussi parce qu'il ne faut pas que les arrêts fassent à chaque fois
soixante pages.
Ce
que je regrette le plus, dans l'arrêt, ce n'est pas la solution retenue, mais
une partie de la motivation, lorsque la Cour, in fine, donne des conseils sur ce
que la Cour d'appel auraît dû faire pour ne pas porter atteinte au principe du
contradictoire. La Cour suggère en effet que l'on aurait pu envoyer " une
demande adressée aux requérants afin de recueillir leurs observations écrites
en cours de délibéré"... Cela m'a semblé un peu étrange que la Cour
d'appel ait à envoyer une note écrite en leur demandant : cela ne vous embêterait
pas d'être complices plutôt que co-auteurs... Je ne pense pas qu'en matière pénale
cette pratique soit très appropriée.
De
ce point de vue là, les conseils de la Cour ne me semblent pas adéquats.
Jean-Paul
COSTA
Je
voudrais encore dire sur cet arrêt qui attire plus pour l'instant que l'arrêt Fressoz
et Roire ou Lemoine, qu’en réalité, nous avions plongé dans la
jurisprudence du 19ème siècle, et même dans le Traité de procédure pénale
de Faustin Hélie, le grand pénaliste, et on avait bien vu que c'était en
effet une création purement prétorienne, et je crois qu'elle n'est pas confirmée
par la jurisprudence récente. Malgré tout j'essaie moi de me mettre dans la
peau de quelqu'un qu'on accuse de banqueroute ! Lui dire : vous n'avez pas
commis de banqueroute, mais vous êtes quand même complice de banqueroute... Si
je reprends une formule du genre emporte-pièce, je dirai que cela me fait
penser au loup et à l'agneau : si ce n'est toi, c'est donc ton frère,
c'est donc quelqu'un des tiens. Si ce n’est pas toi, tu es quand même
complice de l'autre, c'est un peu “ limite ”...
Arlette
HEYMANN-DOAT (professeur à l’Université
de Paris XI)
Une
question à Antoine Buchet. Il nous a dit qu'il avait fait des notes
d'information pour les magistrats pour leur dire de ne pas se refaire condamner
une nouvelle fois sur les questions tirées des arrêts Fressoz et Roire
ou Pélissier et Sassi. Est-ce que c'est une pratique nouvelle, et est-ce
que c'est une pratique générale ? Sur le fond, je vois bien ce que vous avez
voulu dire aux magistrats concernant l'affaire Pélissier et ce qu'il ne
faut pas faire, mais dans l'affaire Fressoz et Roire, qu'est-ce que vous
avez pu leur dire aux magistrats ? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire ?
Antoine
BUCHET
Ce
sont des notes d'information, non des circulaires. On ne dit pas aux magistrats
: faites ceci, faites cela. Simplement, on sait que la Convention est connue et
appliquée par les juridictions. On sait, qu'en revanche, la jurisprudence est
moins accessible et moins connue et que donc au lieu de diffuser les arrêts à
l'état brut, ce qui rebute parfois les lecteurs, nous essayons au Ministère de
diffuser des notes de synthèse. Ces notes n'ont pas pour objet d'instruire le
procès de la justice française et de donner des directives. Elles ont pour
objet d'informer et d'appeler l'attention des magistrats sur les conséquences
qu'on peut tirer d'un arrêt.
Il
y a donc une partie explicative, et quelques mots de conclusion, qui ne sont pas
" directifs ". Ce sont des notes d'information, de sensibilisation,
qui n'indiquent aucune " marche à suivre ". On rappelle le sens de
l'arrêt pour inviter à la réflexion par rapport à cette jurisprudence. Dans
l'affaire Pélissier et Sassi nous avons essayé de mettre en évidence
cette notion de respect du contradictoire et la nécessité de rouvrir les débats,
ou au moins d'alimenter les débats judiciaires autour de cette notion de
qualification pénale qui effectivement est peut-être mal traitée devant les
juridictions pénales comme le démontre d'ailleurs la pratique de la peine
justifiée.
Sur
l'arrêt Fressoz et Roire, c'est précisément l'application de la
qualification de recel, qualification de droit commun, aux journalistes, généralement
poursuivis sous le couvert de la loi de 1881, qui nous semblait devoir être mis
en exergue.
Je
crois qu'il est nécessaire d'appeler l'attention des magistrats sur
l'extraordinaire rigueur du contrôle exercé par la Cour, pour qui la liberté
de la presse est l'un des piliers de la Convention et du système démocratique
en Europe. Cette jurisprudence sur l'article 10 est encore très mal connue en
France, et l'on ne manque jamais une occasion d'appeler l'attention du cabinet
de la Ministre et des parlementaires éventuellement, sur cette jurisprudence,
au regard, notamment, de la volonté de certains hommes politiques de
"cadenasser" un peu mieux l'accès aux procédures en cours, en
appelant leur attention sur le fait que si on cadenassait davantage ces procédures,
on se ferait immanquablement condamner encore plus à Strasbourg.
Jean-Paul
COSTA
Je
voudrais ajouter, je ne sais plus si Antoine Buchet l'a précisé ou pas, mais
en réalité le recel était doublement bizarre dans cette affaire. D'une part,
parce que comme vous l'avez dit, surtout pour un journal comme le “ Canard
enchaîné ”, la crédibilité de ses allégations est nécessairement
étayée par des photocopies. Et d'autre part, la Cour d'appel a finalement
condamné à une amende de 10 000 francs et de 5 000 francs respectivement
chacun des deux journalistes pour le motif de recel de violation du secret
professionnel. On était là presque à la limite de la violation de la présomption
d'innocence. D'ailleurs vous nous avez dit que la Cour n'a pas jugé nécessaire
d'examiner…. Parce que vous nous avez parlé assez drôlement de
fonctionnaires non identifiés, des espèces d'OVNI de la fonction publique,
mais comment peut-on affirmer qu'il y a eu recel de violation du secret
professionnel, s'il n'y a pas eu identification ? Alors bien sûr, le
raisonnement de la Cour d'appel était un raisonnement hypothétique qui disait
: ça ne peut être que des gens des impôts qui ont photocopié ces avis
d'imposition, donc il y a eu vol, donc il y a eu recel. Je me retourne à
nouveau vers le pénaliste, ce n'est pas extraordinairement rigoureux. Mais on
ne s'est pas du tout placé sur ce terrain.
François-Guilhem
BERTRAND
Une
remarque de droit processuel. Au fond, le problème de la requalification et le
problème de la saisine in rem se posent devant tous les ordres de
juridictions, aussi bien devant l'ordre administratif que devant l'ordre civil,
ou répressif. Je ne vois pas pourquoi il existe un article 12 devant les
juridictions civiles, un article 153-1 du Code des tribunaux administratifs et
des Cours administratives d'appel, qui obligent le juge lorsqu'il est sur le
point de soulever un moyen de pur droit, ou de soulever un moyen d'ordre public,
à réouvrir les débats et de provoquer les explications des avocats sur ce
moyen d'ordre public.
Vous
vous souvenez peut-être M. le Conseiller d'Etat qu'il y a eu, lorsque cette
disposition a été introduite, une certaine réticence de la part de certains
avocats et de certains magistrats surtout, disant : nous ne sommes pas là
pour faire l'apprentissage de MM les avocats. S'ils n'y ont pas pensé, tant pis
pour eux. De toute façon, cela s'impose à nous comme à tout le monde, donc ce
n'est pas la peine de réouvrir les débats et de provoquer un débat
contradictoire.
Or
je crois qu'aussi bien la Cour de cassation que le Conseil d'Etat ont
aujourd'hui pleinement adapté leur position, et que le caractère
contradictoire du débat l'emporte sur l'obligation pour les parties de soulever
le moyen. Je crois qu'en matière pénale il en va de même. Le problème de la
peine justifiée est au fond la même chose. Lorsqu'on a condamné pour vol, si
on doit ensuite condamner pour recel parce qu'un des éléments du vol n'apparaît
pas pleinement, peut-être que la Cour d'appel s'est trompée, et peut-être
vaudrait-il mieux renvoyer devant elle que de faire cette espèce de tour de
"passe-passe" qui tend à prouver que la Cour de cassation est moins là
pour faire du droit que du disciplinaire. Au fond, vous avez bien jugé, vous
lui avez donné trois mois, n'en parlons plus. Du vol, du recel, tout cela est
égal. Ce qui compte c'est la peine, il méritait ses trois mois, il les a eus,
n'en parlons plus.
Une
remarque pratique : on vient de nous dire à l'instant, dans un cas précis, que
le plumitif d’audience ne portait rien. Je pense qu’il est extrêmement intéressant
de savoir comment se déroulent les débats aujourd'hui devant une juridiction pénale
ordinaire et comment le juge de cassation, et a fortiori la Cour de
Strasbourg, peut savoir ce qui s'est réellement passé ce jour là pendant les
débats. L'huissier est parti faire un tour, il n'y a rien et on ne sait pas si
le moyen a été agité, si la cote 164 a été ou n'a pas été discutée. Il
est très rare aujourd'hui que les plaidoiries des avocats soient publiées,
elles l'étaient parfois au 19ème siècle, elles le sont de moins en moins. On
ne sait pas quels sont les arguments qui ont été soulevés. Du coup, le contrôle
aussi bien de la Cour de cassation que de la Cour de Strasbourg devient
extraordinairement aléatoire.
J'ajoute
une deuxième remarque pratique : aujourd'hui, devant certaines juridictions,
malheureusement, lorsque vous allez prendre le jugement ou l'arrêt, il n'y a
rien, il y a “ trois mois ”, et si vous faites appel, alors vous
aurez peut être la chance d'avoir enfin un jugement. Les jugements, en tout cas
au tribunal de Paris, ne sont pas rédigés. Je ne sais pas ce qu'en pense la
Cour de Strasbourg, mais personnellement en tant qu'ancien avocat, cela ne me
paraît pas tout à fait normal de faire appel d'un jugement quand on n'en connaît
pas la teneur. Que vis-à-vis du client, si vous revenez du Palais, vous lui
disiez : on a pris trois mois, ou vous avez "ramassé" trois
mois, pour telle ou telle raison, ce n'est pas du tout la même chose. Dans un
cas votre client dit, on fait appel, parce que sans motivation il est en droit
de savoir pourquoi il a été condamné ; en revanche, s'il a connaissance de la
motivation, vous pouvez lui indiquer que la peine est justifiée et qu'il ne
convient pas de faire appel. Sur de petits points pratiques comme ceux là, et
M. Buchet est un praticien et il le sait, certains usages conduisent parfois à
des arrêts de principe qu'on aurait pu très facilement éviter en suivant tout
simplement les règles élémentaires du contradictoire, ou de la communication.
Jean-Paul
COSTA
M.
Allix va vous répondre sur le premier point. Sur le second, je vous dirai que
la Cour ne pense rien, puisqu'il n'y a pas eu de griefs de ce type formulés
devant elle. A titre purement personnel, je trouve qu'il est quand même normal
que les jugements soient motivés. Là où se pose le plus grave problème, me
semble-t-il, c'est pour la Cour d'assises car pour elle, on n'a rien. On n'a pas
de véritable motivation, on n'a pas de compte rendu d'audience...
Dominique
ALLIX
Les
arrêts de la Cour d'assises sont motivés... Voyez la feuille de questions et
le verdict, la chambre criminelle en vérifie la cohérence. Il faut que cette
idée fallacieuse cesse d'être répandue...
Jean-Paul
COSTA
L'arrêt
Papon est assez motivé et je vous signale, mais vous le savez sans doute déjà
par la presse, qu'il y a quelques jours les avocats de Papon ont déposé une
requête devant la Cour européenne en soulevant douze griefs de violation de la
Convention, et dans la foulée, on a deux autres requêtes contre la France qui
viennent d'être enregistrées, l'une de Michel Charasse, parce qu'il se plaint
d'avoir été condamné à 10 000 francs d'amende pour avoir refusé de déférer
à une convocation du juge ; l’autre, de M. Le Pen, qui considère que
l’avoir condamné pour avoir frappé quelqu’un dans une campagne électorale
n’était pas un procès équitable. Essayez de vous mettre à la place du juge
français, entre Papon, Charasse et Le Pen... Avant d’être Conseiller d’Etat,
puis juge permanent à la Cour européenne, j’ai été étudiant en droit, et
j’ai même été professeur associé...
Dominique
ALLIX
Je
voudrais répondre à M. Bertrand. Pourquoi est-ce que nous n’avons pas
d’article 12 du nouveau Code de procédure civile dans notre Code de procédure
pénale ? D’abord, mais c’est une plaisanterie, parce que la procédure pénale
ne saurait s’accommoder de textes réglementaires… Ensuite, et c’est plus
sérieux, parce que la tradition inquisitoriale de notre procédure pénale
s’y oppose. L’idée sous-jacente est que la maîtrise de la qualification
autorise à s’affranchir des exigences du contradictoire…
Vincent
DELAPORTE
Sur
la motivation, il y a beaucoup à dire. Les arrêts d’assises ne sont pas
motivés. Quand on répond par oui ou par non, ce n’est pas une motivation. La
Cour n’examine pas les circonstances de fait qui étaient de nature à démontrer
qu’il n’avait pas tué, qu’il n’avait pas volé, qu’il n’y avait pas
de circonstances aggravantes, etc.
Dominique
ALLIX
Vous
savez très bien qu’il faut confronter la feuille des questions, le verdict de
la Cour et l’arrêt de la chambre d’accusation. Je ne peux pas concevoir un
instant que vous puissiez instruire des pourvois contre des arrêts qui ne
seraient pas motivés...
Vincent
DELAPORTE
On
s’adapte aux particularités de la Cour d’assises... Mais ce n’est pas une
véritable motivation. Une motivation par oui ou par non sur un fait brut, sans
discussion ni analyse des circonstances et présomptions qui tendaient à démontrer
que le fait était établi ou non, n’est pas une motivation.
Le
contrôle normal de la motivation vise à obliger les juges à s’expliquer sur
des motifs qui rendaient nécessaire tel ou tel fait ou qui les excluait...
Jean-Paul
COSTA
Je
suis d’autant plus frappé que les arrêts de la Cour d’assises ne soient
pas motivés de façon satisfaisante à mes yeux, qu’en revanche, les débats
devant la Cour d’assises, c’est généralement reconnu, sont des débats de
grande qualité avec un luxe de respect des droits des parties. Il peut y avoir
parfois des bavures ou des mauvaises procédures, mais de manière générale la
justice criminelle en France est une justice qui est entourée de grandes
garanties. Il y a un contraste, ou un décalage, me semble-t-il, entre les débats
tels qu’ils se déroulent pendant un ou plusieurs jours, ou semaines, et cette
motivation QCM, expression utilisée par M. Allix.
Dominique
ALLIX
Les
questions ne sont pas seulement posées à partir de l’arrêt de renvoi, elles
le sont aussi à partir des débats.
Jean-Paul
COSTA
Le
professeur Bertrand disait : que fait la Cour de Strasbourg par rapport à des
choses comme celles-là ? Quand on voit un arrêt de Cour d’assises française,
on se pose beaucoup de questions... On se demande effectivement souvent sur quoi
s’est fondée la Cour pour rendre son arrêt...
|