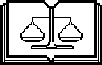|
Droits de l'Homme et prison
Les développements récents de
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme
par
Françoise TULKENS
Juge à la Cour européenne des
droits de l'Homme
Introduction
Quels sont les apports de la
Convention européenne des droits de l'Homme et de la jurisprudence de la
nouvelle Cour (1998-2001) à la question de la prison ? J’inscrirai cette
question dans le contexte du développement progressif du droit pénitentiaire que
l’on observe aussi bien en droit interne qu’en droit international et qui est
qualifié par certains de “ révolution tranquille ”
et par d’autres d’“ illusion internationale ”.
Si, comme nous le verrons, de
nombreuses dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme
croisent, directement ou indirectement, la question de la peine et de la peine
privative de liberté, en fait la Convention n’a pas été élaborée, de manière
spécifique, pour les détenus. Ce sont dès lors les dispositions générales de la
Convention qui peuvent et doivent être mobilisées pour interroger, au regard des
droits de l'Homme, la question de la détention, sous la seule réserve toutefois
que la Cour ne pourra examiner la situation des détenus ou de la détention que
dans la mesure où celle-ci porte atteinte à un droit garanti par la Convention.
D’un côté, les droits garantis par la Convention valent pour tout le monde, donc
aussi pour les personnes détenues. La privation de liberté ne constitue pas, en
principe, une limitation aux droits fondamentaux. La théorie des limitations
implicites inhérentes à la privation de liberté, initialement utilisée par la
Commission européenne des droits de l'Homme, a été rejetée par la Cour dans
l’arrêt Golder c/Royaume-Uni du 21 février 1975 : toutes les limitations
aux droits fondamentaux doivent être strictement légitimées selon les critères
de la Convention. Comme l’a affirmé la Cour, “ la justice ne saurait s’arrêter à
la porte des prisons ” (arrêt Campbell et Fell c/Royaume-Uni, 28 juin
1984, § 69). D’un autre côté, les limitations aux droits garantis qui sont
inscrites dans la Convention elle-même (notamment dans les articles 8 à 11)
s’appliquent aux détenus comme à tous les autres justiciables.
C’est dans ce contexte que
j’examinerai, à la lumière de la jurisprudence récente de la nouvelle Cour
européenne des droits de l'Homme qui est entrée en fonction le 1er novembre
1998, les ressources fournies par certains des droits garantis par la
Convention. Mais il convient de rappeler que la Cour ne peut intervenir que si
elle est saisie et après l’épuisement des voies de recours internes car nous
croisons ici une difficulté majeure. L’accès des détenus aux juridictions
internes n’est déjà pas chose aisée, en raison notamment de leur situation de
vulnérabilité sociale. Les obstacles sont tout autant économiques que sociaux et
culturels. Il est encore plus difficile pour les juridictions internationales.
Inversement, la décision de recevabilité du 18 septembre 2001 dans l’affaire
Kalashnikov c/Russie mérite aussi d’être signalée. Au gouvernement qui
soulevait l’exception du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour
répond que s’il est sans doute exact que le requérant n’a pas utilisé les
différents recours qui existaient à l’époque des faits, elle observe que les
problèmes qui résultent de la surpopulation dans les établissements où les
détenus sont en détention préventive sont apparemment de nature structurelle et
ne concernent pas seulement sa situation individuelle. Le gouvernement n’apporte
donc pas la preuve que ces recours auraient pu corriger la situation, étant
donné les difficultés économiques auxquelles sont confrontées les autorités
pénitentiaires (“ given the acceptable economic difficulties of prison
administration ”).
I • Le droit à la vie
Si des détenus décèdent en
prison (combien chaque année ?), la question qui se pose est celle de la
responsabilité des autorités qui doivent protéger le droit à la vie. La Cour
pourrait être saisie de requêtes suite à des grèves de la faim dans des prisons
en Turquie qui ont conduit à la mort des détenus.
A. Le suicide en prison
Dans la requête Keenan
c/Royaume-Uni (arrêt du 3 avril 2001, 3ème section), la mère d’un jeune
détenu, malade mental, qui s’est suicidé pendant qu’il était placé en isolement
cellulaire, pour des raisons disciplinaires, invoque l’article 2 de la
Convention et le devoir qui incombe à l’État de protéger le droit à la vie.
Après avoir rappelé que l’article 2 ne se limite pas à une abstention d’agir
mais contient aussi une obligation positive de prendre les mesures nécessaires
pour protéger ce droit, la Cour estime que l’obligation ne peut être impossible
ou disproportionnée et que le risque, dès lors, que les autorités doivent
prévenir doit être connu et prévisible (§§ 88-89). Dans les circonstances de
l’espèce, elle estime que les responsables de la prison ont adopté une “ réponse
raisonnable ” à la situation du fils de la requérante, notamment par une
supervision médicale journalière et un contrôle toutes les quinze minutes (§
98). Elle conclut à la non-violation de l’article 2 de la Convention.
La requête Younger
c/Royaume-Uni, actuellement pendante devant la Cour, concerne également le
suicide en prison du fils de la requérante. En l’espèce, une question se pose,
au niveau de la recevabilité, quant au délai de six mois pour introduire la
requête devant la Cour (article 35 § 1 de la Convention). Ce délai doit-il être
calculé à partir du décès ou à partir des résultats de l’enquête sur le décès de
son fils ?
B. Des meurtres commis par
des détenus et la responsabilité de l’État
J’évoquerai ici une situation
voisine : il s’agit de requêtes présentées à la Cour par les parents de victimes
qui soulèvent, sous le visa de l’article 2 de la Convention, la question de la
responsabilité de l’État pour des meurtres commis par des détenus en permission
de sortie.
La requête Bromiley
c/Royaume-Uni a été déclarée irrecevable, sous l’angle de l’article 2 de la
Convention, par une décision de la Cour (3ème section) du 23 novembre 1999.
Certes, l’article 2 impose à l’État l’obligation positive de prendre les mesures
nécessaires à la protection du droit à la vie des personnes relevant de sa
juridiction. Toutefois, l’étendue de cette obligation dépend des circonstances
de l’affaire et notamment des choix opérationnels effectués en termes de
priorité et de ressources. Il est donc nécessaire d’interpréter cette obligation
de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer que les autorités savaient ou
auraient dû savoir, que la personne détenue risquait de commettre un crime
violent si elle bénéficiait d’une permission de sortie. Il n’existait aucun
diagnostic médical, notamment de maladie mentale, indiquant que le détenu
représentait une menace pour la vie et, auparavant, il avait réintégré à deux
reprises la prison à l’issue de ses permissions, sans aucun incident. Il
n’existait donc aucun élément indiquant que si l’intéressé ne revenait pas de sa
permission, la fille de la requérante courait un risque prévisible. Il
n’apparaissait pas non plus que les autorités avaient manqué à l’obligation de
prendre les mesures dont elles pouvaient raisonnablement disposer afin de
garantir la “ capture ” de la personne détenue avant qu’elle ne commît un
nouveau crime. Dès lors, le départ de l’intéressé en permission, peu avant la
fin de sa peine, ne révèle en soi aucun manquement à l’obligation de protéger la
vie de la fille de la requérante.
En revanche, la requête
Mastromatteo c/Italie a été déclarée recevable par une décision de la Cour
(2ème section) du 14 septembre 2000. En l’espèce, le meurtrier du fils du
requérant se trouvait en semi-liberté et avait obtenu une permission de sortie
de quarante-huit heures, au terme de laquelle il n’avait pas regagné la prison.
Le juge d’application des peines chargé du suivi de la détention avait accordé
la permission de sortie en considérant, sur la base des rapports établis par les
autorités pénitentiaires quant à son comportement en milieu carcéral, qu’il ne
présentait pas de danger pour la société. Toutefois, le détenu se vit octroyer
cet aménagement de la peine sans que le rapport de personnalité prescrit par la
loi, dans cette hypothèse, n’ait été établi. Par ailleurs, le juge d’application
des peines n’a pas fait usage de la faculté dont il disposait de demander à la
police des renseignements complémentaires afin d’évaluer si le détenu et ses
complices avaient conservé des liens avec des organisations criminelles opérant
à l’extérieur de la prison. De tels renseignements auraient, en effet, pu
justifier un refus d’octroi de la permission de sortie. Enfin, bien que la
permission ait été assortie de mesures de contrôle, la police ne semble pas
avoir exercé, à cette occasion, une quelconque surveillance sur l’intéressé.
Cette affaire a fait l’objet d’un dessasissement au profit de la Grande chambre
qui tiendra une audience en mars 2002.
II • L’interdit de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
La Cour a plusieurs fois répété
que l’article 3 exprime une des valeurs les plus fondamentales de la société
démocratique et requiert une vigilance extrême. Il ne peut subir ni dérogation,
ni restriction car il contient une garantie absolue, intangible “ même dans les
circonstances les plus difficiles, telles la lutte contre le terrorisme et le
crime organisé ” (Selmouni c/France, arrêt du 28 juillet 1999, Grande
Chambre, § 95 ; Daktaras c/Lituanie, arrêt du 10 octobre 2000, 3ème
section, § 32). L’article 3 traduit aussi le caractère objectif des droits
fondamentaux : les personnes les possèdent en raison de la dignité attachée à la
personne humaine, quels que soient les actes qu’elles ont commis (V. et T.
c/Royaume-Uni, arrêts du 16 décembre 1999, Grande Chambre).
En l’absence de définition
des comportements prohibés par l’article 3, la Cour européenne des droits de
l'Homme doit procéder à une interprétation de cette disposition, interprétation
autonome et évolutive, qui est au cœur de l’effectivité de la garantie prévue
par la Convention. Toutefois, dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle,
l’interprétation par la Cour de l’article 3 de la Convention, qui consacre un
standard minimum, se distingue de la préoccupation du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
qui, dans l’exercice de sa fonction de prévention, peut pointer et identifier
des situations plus larges. Même si la situation est en dehors de notre sujet
limité à la détention en prison, rappelons que la torture a été retenue pour la
première fois par la Cour dans l’arrêt Selmouni c/France du 28 juillet
1999 ainsi que dans les arrêts Salman c/Turquie du 27 juin 2000 et
Ilhan c/Turquie du même jour. Par ailleurs, l’article 3 contient une
distinction entre la notion de torture et de peine ou traitement inhumain ou
dégradant. Si les peines ou traitements inhumains visent l’intégrité et
concernent plus particulièrement des lésions ou des souffrances physiques ou
morales, les peines ou traitements dégradants s’attachent plutôt à la dignité de
la personne, en suscitant chez elle peur, angoisse, avilissement. Ainsi, dans
l’arrêt Valasinas c/Lituanie du 24 juillet 2001, la Cour estime que le
fait d’obliger le requérant à se dévêtir entièrement en présence d’une femme
officier qui a procédé ensuite à une fouille intime “ manifeste un manque
évident de respect et diminue en fait la dignité humaine. Ceci a dû le laisser
avec un sentiment d’angoisse et d’infériorité susceptible de l’humilier et de le
déstabiliser ” (§ 117). Elle conclut dès lors, en ce qui concerne cette fouille,
à un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Dans
l’affaire H.G. c/Suisse, le requérant se plaignait, au titre de
traitement inhumain et dégradant, du fait d’être autorisé à sortir en ville mais
menotté. La Cour a cependant pris une décision d’irrecevabilité le 15 novembre
2001 (4ème section) dans la mesure où, d’une part, le requérant n’avait pas
épuisé les voies de recours internes et où, d’autre part, il ne pouvait plus
être considéré comme victime au sens de l’article 34 de la Convention : le
président de la cour cantonale a en effet ordonné une sortie sans menottes dans
la mesure où pareille situation constituait une violation de la dignité humaine.
Enfin, afin d’assurer aux droits
fondamentaux leur effectivité la plus large, la Cour a depuis longtemps précisé
qu’un risque sérieux, réel, immédiat, d’agissements prohibés par l’article 3
peut aussi tomber sous le coup de cette disposition (Soering c/Royaume-Uni,
arrêt du 7 juillet 1989, §§ 82 et 91) et cette jurisprudence se trouve confirmée
dans la décision d’irrecevabilité du 16 octobre 2001 de la nouvelle Cour dans la
requête Einhorn c/France : “ La Cour rappelle que le fait que,
consécutivement à sa condamnation à mort, un détenu se trouve exposé au syndrome
du couloir de la mort peut, dans certains cas et eu égard notamment au temps à
passer dans des conditions extrêmes, à l’angoisse omniprésente et croissante de
l’exécution et à la situation personnelle de l’intéressé, être considéré comme
un traitement dépassant le seuil fixé par l’article 3 de la Convention ” (§ 26).
Dans l’affaire Nivette c/France, qui a fait l’objet d’une décision
d’irrecevabilité du 3 juillet 2001, la Cour, après avoir eu des assurances que
le requérant ne serait pas envoyé dans le couloir de la mort, s’est attachée à
vérifier si le requérant risquait effectivement une condamnation à la prison à
vie incompressible dans l’État vers lequel il devait être extradé. La requête
Yang Chun Jin alias Yang Xiaolin c/Hongrie, concernant l’extradition
vers la Chine où le requérant risque la réclusion, a été rayée du rôle par un
jugement du 8 mars 2001, en application de l’article 37 § 1 b) de la Convention,
suite à la décision du ministre de la Justice de refuser l’extradition et au
départ du requérant vers la Sierra Leone.
A. Le champ d’application
En ce qui concerne le champ
d’application de l’article 3 de la Convention, la Cour indique que la
détention ordinaire ne rentre pas, en tant que telle, dans le champ
d’application de l’article 3 de la Convention. A contrario, en ce qui
concerne les détenus, les souffrances doivent aller au-delà de celles que
comportent inévitablement les exigences légitimes de la peine. Toute la
question, bien sûr, est de savoir quelles sont, concrètement, les “ exigences
légitimes de la peine ”, ce qui pose nécessairement la question du but de la
peine et de la peine privative de liberté. La frontière est étroite car,
inversement, on pourrait soutenir qu’un emprisonnement qui met en péril les
objectifs mêmes de la détention, à savoir la prévention et la réinsertion, est
susceptible de constituer en lui-même un traitement inhumain et dégradant. Cette
observation rejoint, d’une certaine manière, une question soulevée, en France,
dans le rapport du premier président de la Cour de cassation, M. G. Canivet :
les surveillants regrettent que dans leur travail quotidien, la mission de
réinsertion de la prison ne soit pas prise en compte et que cette tâche est
considérée comme résiduelle, voire utopique, par rapport aux impératifs de
sécurité.
Les contours de la “ détention
ordinaire ” ne sont pas non plus, quant à eux, aisés à déterminer. Ainsi, la
question de la détention en attente d’expulsion commence à se poser de
manière de plus en plus fréquente. Dans l’affaire Zhu c/Royaume-Uni
(décision du 12 septembre 2000, 3ème section) qui concernait les conditions de
détention d’une personne dans l’attente de son expulsion, la Cour a certes
déclaré la requête irrecevable. Mais elle a cependant précisé qu’il n’est pas
souhaitable que les détenus dans l’attente d’une expulsion soient enfermés dans
les mêmes établissements que les condamnés. En l’espèce, toutefois, les
autorités pénitentiaires ont fait des efforts pour atténuer les désagréments de
cette situation (un interprète fut mis à la disposition de l’intéressé et des
mesures spéciales furent prises après sa tentative de suicide pour prévenir
toute récidive, ce qui permet d’établir qu’il a été tenu compte des tendances
suicidaires du requérant). Enfin, et ceci pose aussi la question de la
“ détention ordinaire ” au regard de la diversification des peines et mesures de
sûreté, le grief fondé sur le fait qu’une personne, après avoir subi sa peine,
reste sous surveillance pour le reste de sa vie, a été jugé jusqu’à présent par
la Cour comme en dehors du champ d’application de l’article 3 de la Convention.
Enfin, une nouvelle question se
pose de manière de plus en plus insistante, celle de la compatibilité d’une
peine perpétuelle incompressible avec l’article 3 de la Convention. Dans la
requête Einhorn c/France, “ la Cour n’exclut pas que la condamnation
d’une personne à une peine perpétuelle incompressible puisse poser une question
sous l’angle de l’article 3 de la Convention ” (décision du 16 octobre 2001),
faisant référence notamment au Rapport général sur le traitement des détenus en
détention de longue durée du Comité européen pour les problèmes criminels (1977)
et la Résolution (76)2 “ sur le traitement des détenus en détention de longue
durée ” adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe (§ 27). En
l’espèce, toutefois, la Cour a déclaré la requête irrecevable car les autorités
de Pennsylvanie pouvaient commuer une peine de réclusion perpétuelle en une
autre durée, susceptible de permettre la libération conditionnelle.
B. Les conditions
d’application
Trois éléments sont généralement
requis comme conditions d’application de l’article 3 : l’intention, la gravité
et l’absence de justification. Même si, par souci de clarté, nous partons de ces
différentes conditions, il convient d’observer qu’elles sont relatives et ont
peut-être même tendance à s’estomper.
1) L’élément intentionnel
Cet élément se retrouve, par
exemple, dans l’arrêt Magee c/Royaume-Uni du 6 juin 2000 (3ème section) :
l’austérité des conditions de détention, rapportées notamment par le CPT, était
conçue pour exercer une pression psychologique et briser la résolution de
l’intéressé de garder le silence. La question de savoir si le traitement infligé
avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime est un élément qui a été
pris en compte dans les arrêts V. et T. c/Royaume-Uni du 16 décembre 1999
où la Cour a estimé que le procès pénal qui a été imposé aux deux enfants, âgés
de onze ans à l’époque du procès, ne constituait pas, notamment pour cette
raison, un traitement dégradant (§§ 71 et 69). Néanmoins, elle a précisé que
l’absence de pareille volonté ne saurait, en tant que telle, exclure dans tous
les cas un constat de violation de l’article 3.
L’élément intentionnel pose
toutefois la question des traitements objectivement inhumains et
dégradants. Jusqu’à présent, la Cour ne sanctionnait que des formes ou plutôt
des actes de mauvais traitements qui sont infligés de manière violente et non
justifiée, dans le but d’humilier ou de rabaisser la personne, ce qui excluait
notamment les mauvais traitements liés aux conditions de vie elles-mêmes en
prison : surpopulation chronique, insuffisance des règles d’hygiène, pauvreté et
indigence, absence d’intimité, transfert des détenus, défaut ou absence de
soins, etc. Une certaine évolution paraît cependant s’amorcer qui, d’une
certaine manière, rejoint l’exigence formulée par l’article 1er des Règles
pénitentiaires européennes : “ La privation de liberté doit avoir lieu dans des
conditions matérielles et morales qui assurent le respect de la dignité
humaine ”. En inversant la constatation de J.-P. Céré, cette évolution est
peut-être liée, en partie tout au moins, au fait que les requérants placent
désormais davantage le débat sur le terrain général des conditions de détention
que sur celui des actes isolés de mauvais traitements.
Si certaines requêtes concernent
les conditions générales de détention, d’autres interrogent ces conditions dans
des lieux particuliers ou des situations particulières.
a) Les conditions générales de
détention
J’évoquerai trois décisions
successives qui s’attachent à cette question, tout en signalant que d’autres
requêtes sont actuellement pendantes devant la Cour soulevant des problèmes du
même ordre (Kalashnikov c/Russie, Shepelev c/Russie, Mikadze
c/Russie, Gorodnichev c/Russie).
Dans l’arrêt Kudla c/Pologne
du 26 octobre 2000, rendu en Grande Chambre, la Cour affirme, pour la première
fois me semble-t-il, le droit de tout prisonnier à des conditions de détention
conformes à la dignité humaine. Un tel droit implique que les modalités
d’exécution de la peine de prison “ ne soumettent pas l’intéressé à une détresse
ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance
inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de
l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de
manière adéquate, notamment par l’administration de soins médicaux ” (§ 94). En
l’espèce toutefois, comme le requérant avait bénéficié en prison des soins
médicaux (psychiatriques) que réclamait son état, il a été jugé qu’il ne pouvait
se prévaloir de l’article 3.
Dans l’arrêt Dougoz c/Grèce
(3ème section) du 6 mars 2001, la Cour a constaté une violation de l’article 3
de la Convention en ce qui concerne les conditions de détention du
requérant, en attente d’expulsion, pendant 17 mois dans les locaux de la police.
Bien que mon examen soit centré sur la détention en prison, j’y inclurai ce cas
en raison de la durée de la détention. La Cour considère que les conditions de
détention peuvent parfois constituer un traitement inhumain et dégradant et elle
se réfère à la décision de la Commission européenne des droits de l'Homme dans
l’affaire grecque (1969) qui a abouti à la conclusion que la surpopulation et
les déficiences en matière de chauffage, de soins, de sommeil, de nourriture, de
loisirs et de contacts avec le monde extérieur constituaient un traitement
inhumain et dégradant. En examinant les conditions de détention, il importe de
prendre en compte l’effet cumulatif de ces conditions, aussi bien que les
allégations spécifiques faites par le requérant. En l’espèce, bien que la Cour
n’ait pas mené une visite sur place, elle observe que les griefs du requérant
sont confirmés par les conclusions du rapport du CPT du 29 novembre 1994 qui
souligne que l’organisation des cellules et le régime de détention n’étaient pas
acceptables pour une période qui excède quelques jours, que le taux d’occupation
était largement excessif et que les dispositions sanitaires manquaient. A la
lumière de ces considérations, la Cour estime que les conditions de détention du
requérant, en particulier une surpopulation sévère, jointes à la longueur de la
période pendant laquelle il a été détenu dans de telles conditions, constituent
un traitement dégradant contraire à l’article 3 (§§ 46-48).
L'affaire Peers c/Grèce
qui a été plaidée devant la Cour le 5 octobre 2000 est sans doute encore plus
nette et sa motivation plus explicite. Elle concerne les conditions de détention
d'un héroïnomane à la prison de Koridallos, dans une unité séparée (segregation
unit). Dans son jugement du 19 avril 2001 (2ème section), la Cour conclut à
la violation de l’article 3 de la Convention. Dans la partie en fait, il est
intéressant d’observer que la Cour rappelle, parmi les circonstances de
l’affaire, les constatations et les recommandations contenues dans le rapport du
CPT du 29 novembre 1994, suite à la visite effectuée à la prison de Koridallos
en mars 1993 (§ 61). Dans la partie en droit, en réponse à l’objection du
gouvernement selon laquelle le requérant aurait lui-même demandé à être détenu
dans l’unité séparée, la Cour observe que le requérant n’a pas été, au départ,
placé de son plein gré dans l’unité séparée mais qu'il s’agissait d’une décision
de la direction en raison du fait qu’il souffrait du sevrage. Par après,
lorsqu’il a demandé d’être transféré, il lui a certes été proposé de rejoindre
une autre aile de la prison mais une aile où sont rassemblés les détenus
toxicomanes et où, semble-t-il, de la drogue circule, ce qu’il refusa. Refus
légitime, estime la Cour : dans ces conditions, on ne peut soutenir que le
requérant consentit à être détenu dans l’unité séparée. Concernant alors les
conditions de détention dans cette unité, la Cour se fonde sur les observations
de la Commission européenne en ce qui concerne la taille, la lumière, la
ventilation, la chaleur de la cellule du requérant dans laquelle il était
enfermé le soir et la nuit et qu’il devait, en outre, partager avec un autre
détenu (§ 72). Elle observe, en particulier, la situation de la toilette (de
type asiatique), sans séparation (§ 73). Certes, la Cour admet qu’il n’y avait
pas, en l’espèce, intention ou volonté d’humilier le requérant. Toutefois, si un
tel facteur doit être pris en considération, l’absence de celui-ci ne peut
conduire à exclure une violation de l’article 3 de la Convention (V.
c/Royaume-Uni, 16 décembre 1999, § 71). En outre, en l’espèce, les autorités
n’ont pris aucune mesure pour améliorer les conditions de détention du requérant
objectivement inacceptables, et pareille omission dénote un manque de
respect. Pendant au moins deux mois, le requérant a passé une partie importante
de chaque 24 heures confiné sur son lit, dans une cellule surchauffée, sans
ventilation, ni fenêtre. Il devait utiliser les toilettes en présence de l’autre
détenu et lui-même devait assister aux besoins naturels de celui-ci. La Cour
n’est pas convaincue par l’argument du gouvernement selon lequel ces conditions
n’auraient pas affecté le requérant d’une manière incompatible avec l’article 3
de la Convention. Au contraire, elle estime que les conditions de détention ont
porté atteinte à la dignité humaine du requérant et ont fait naître en
lui un sentiment d’angoisse et d’infériorité de nature à l’humilier et à briser
sa résistance physique et morale.
En revanche, dans la requête
Valasinas c/Lituanie, qui soulevait aussi la question des conditions
générales de détention (surpeuplement, conditions sanitaires et nutritionnelles,
encadrement médical, absence de travail), la Cour a mené une enquête sur place
et elle a abouti en définitive à un constat de non violation de l’article 3 de
la Convention (arrêt du 2001, §§ 98 à 113).
b) Des lieux de détention
Deux requêtes c/les Pays-Bas
(Van der Ven et Lorsé) ont fait l’objet de décisions de recevabilité le 28 août
2001 et elles concernent les conditions de détention dans des quartiers
spéciaux, en l’espèce des unités de haute sécurité (“ EBI ”, extra
beveiligheid inrichting et “ TEBI ”, tijdelijke extra beveiligheid
inrichting) d’un centre pénitentiaire du sud du pays. Un des requérants qui
purge une peine de quinze ans d’emprisonnement pour des infractions à la
législation sur les stupéfiants et les armes à feu, a été détenu à l’EBI du 27
septembre 1994 au 15 janvier 2001 tandis que l’autre était en détention au TEBI
depuis octobre 1997. Lors de sa visite, le CPT a considéré que le régime de l’EBI
s’analysait en un “ traitement inhumain ”, car il se caractérise par une
sévérité excessive à l’origine d’une insuffisance d’intimité et de contacts
humains, ce qui entraîne la détérioration de l’état physique et psychologique
des prisonniers.
De même, en ce qui concerne les
lieux de détention, il est intéressant de signaler aussi qu’ont été déclarées
recevables les requêtes de détenus condamnés à la peine capitale et qui se
plaignent des conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort,
dans l’attente de leur exécution (Nazarenko, Dankevich, Aliev et Khokhlich
c/Ukraine, décisions du 25 mai 1999, 4ème section).
c) Des situations particulières
La requête introduite par M.
Papon c/France soulève, quant à elle, la question des conditions et du
régime de détention des détenus âgés et parfois, en outre, malades.
Elle a été déclarée irrecevable par une décision de la Cour (3ème section) du 7
juin 2001 dans la mesure où la situation du requérant, liée à son âge avancé et
à son état de santé, n’atteint pas, en l’état, un niveau suffisant de gravité
pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il en
va de même en ce qui concerne les requêtes de A. Sawoniuk c/Royaume-Uni
(décision d’irrecevabilité du 29 mai 2001, 3ème section) et E. Priebke
c/Italie (décision partielle d’irrecevabilité du 5 avril 2001, 2ème
section). Toutefois dans l’affaire Papon, comme l’observe J.-P. Céré, la Cour a
affirmé clairement “ que la détention prolongée d’une personne âgée entre bien
dans le champ de protection de l’article 3 de la Convention ”.
D’autres requêtes, de plus en
plus nombreuses, posent la question des conditions et du régime de détention des
détenus malades, notamment au regard des structures d’accueil et de soins.
Dans l’arrêt Hurtado c/Suisse du 28 janvier 1994, la Cour avait estimé
que le droit de bénéficier de soins médicaux appropriés résulte d’une obligation
positive de l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de
liberté et l’arrêt Kudla c/Pologne du 26 octobre 2000 prolonge cette
jurisprudence en l’étendant aux mesures destinées à assurer le bien être des
détenus (§ 94). La requête McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, qui est
actuellement pendante, pose, pour la première fois, la question des soins
médicaux en prison pour une détenue toxicomane. Actuellement, un nombre accru de
requêtes sont adressées à la Cour qui posent, expressément, la question des
libérations anticipées (et à travers celles-ci les procédures de grâce médicale)
ou des suspensions de peine pour des détenus gravement malades, mettant en jeu
un pronostic vital ou en phase terminale.
Enfin, dans l’arrêt Price
c/Royaume-Uni du 10 juillet 2001, la Cour (3ème section) constate une
violation de l’article 3 (traitement dégradant) dans le cas d’une jeune femme
handicapée des quatre membres, victime de la thalidomide, condamnée pour
contempt of court, et qui se plaignait des conditions de détention dans les
locaux de la police et en prison, conditions manifestement inadaptées à son
état.
2) La gravité
Même si le texte de l’article 3
ne l’exige pas expressément, la Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit
atteindre un “ seuil minimum de gravité ” (Irlande c/Royaume-Uni, 18
janvier 1978, § 163 ; Guzzardi c/Italie, 6 novembre 1980, § 107 ;
Soering c/Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 111), avec une possibilité de
déplacement ou de dégradé vers d’autres dispositions de la Convention, notamment
l’article 8, lorsque ce seuil n’est pas atteint. Dans l’arrêt Ilhan c/Turquie
du 27 juin 2000, on retrouve cette même forme de logique gradualiste dans
l’articulation entre l’article 2 et l’article 3 de la Convention.
La détermination du seuil de
gravité est relative, en ce sens qu’elle dépend à la fois des circonstances du
cas d’espèce, telles que la durée et le régime de la détention ou ses effets
physiques et mentaux, et de la situation de la victime, telles que le sexe,
l’âge ou l’état de santé. Dès lors, le fait, par exemple, que les conditions de
détention du requérant soient en deçà des Règles pénitentiaires européennes
n’est pas suffisant en soi pour conclure à un traitement inhumain et dégradant.
Cette appréciation du seuil de gravité, largement contextualisée, est
extrêmement délicate et requiert une fine dialectique. D’un côté, il y a le
risque perçu par certains d’une forme de banalisation du recours à l’article 3
de la Convention ; de l’autre, il y a le risque, évoqué par d’autres, de la
“ banalité ” du mal.
En ce qui concerne les
circonstances, dans l’affaire Messina c/Italie (décision du 8 juin 1999,
2ème section), la Cour a déclaré irrecevable le grief du requérant qui se
plaignait d’un régime spécial de détention, en rappelant que
“ l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité,
de discipline et de protection, ne constitue pas en elle-même une forme de peine
ou traitement inhumains ”. En l’espèce, la Cour a estimé, d’une part, que
l’isolement était relatif et, d’autre part, que ce régime se justifiait en
raison des liens étroits du requérant avec le milieu mafieux. En outre, elle a
constaté que le régime fut allégé suite à une décision de la Cour
constitutionnelle, les autorités nationales ayant essayé de concilier les droits
des détenus soumis à un régime spécial de détention avec les problèmes auxquels
sont confrontées les autorités carcérales.
En ce qui concerne la situation
de la victime, dans l’affaire Keenan c/Royaume-Uni où, comme nous l’avons
vu, il s’agissait de la situation d’un jeune détenu souffrant de maladie mentale
et placé en isolement disciplinaire, la Commission européenne des droits de
l'Homme n’avait pas estimé qu’il y avait traitement inhumain et dégradant
(rapport du 6 septembre 1999). La Cour ne l’a pas suivie sur ce point et, dans
un arrêt du 3 avril 2001 (3ème section), elle conclut à la violation de
l’article 3 de la Convention. Le manque de surveillance et d’information
psychiatrique sur la situation du fils de la requérante révèle une déficience
dans la prise en charge médicale d’un détenu connu comme étant un sujet à
risque. L’imposition d’une peine disciplinaire, dans ces conditions, constitue
bien un traitement inhumain et dégradant (§ 115). En revanche, dans l’affaire
Bollan c/Royaume-Uni, qui concernait le maintien d’une détenue dans sa
cellule pour des raisons disciplinaires, conduisant à son suicide, la décision
d'irrecevabilité de la Cour du 4 mai 2000 (3ème section) se fonde sur le fait
que les éléments recueillis au cours de l’enquête ont confirmé qu’il n’y avait
pas de raison de penser qu’elle risquait de se suicider ; en outre, la
réclusion, dans sa propre cellule, fut de courte durée.
3) L’absence de justification
Dans l’arrêt Labita c/Italie
(6 avril 2000, Grande Chambre), la Cour rappelle que lorsqu’un individu se
trouve privé de sa liberté, “ l’utilisation à son égard de la force physique
alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte
atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit
garanti par l’article 3 ” de la Convention (§ 120).
C. L’établissement des faits
et la preuve
Il s’agit, en ce qui concerne
l’article 3, de la question la plus difficile et sans doute la plus importante.
En cette matière, comme nous l’avons vu, le CPT est moins tenu par
l’établissement des faits dans le chef d’un requérant individuel et peut donc
pointer et identifier des situations structurelles plus larges. Cependant, la
Cour “ allège ” en quelque sorte la charge qui lui incombe à la fois par le
substitut de la violation procédurale et par l’application au contexte carcéral
de la présomption utilisée dans l’arrêt Tomasi c/France du 27 août 1992
(§§ 108-111) et dans l’arrêt Ribitsch c/Autriche du 4 décembre 1995 (§
34).
Dans l’arrêt Labita c/Italie
du 4 avril 2000 (Grande Chambre), le requérant fut arrêté car on le soupçonnait,
sur base de déclarations de repenti qui ne furent cependant pas corroborées par
la suite, d’appartenir à la mafia. Il prétend avoir fait l’objet de mauvais
traitements (gifles, coups, insultes et mesures d’intimidation) qui étaient
systématiques dans cette prison à ce moment. Même si cette situation fut
confirmée par le juge d’application des peines, les poursuites pénales furent
suspendues à défaut de pouvoir identifier les auteurs. Par une courte majorité
(neuf voix contre huit), la Cour a conclu à la non-violation de l’article 3 sous
son angle substantiel : dans la mesure où le requérant n’a pas produit
d’éléments de preuve à l’appui de ses allégations, la Cour ne dispose pas
d’indices suffisants lui permettant de conclure que celui-ci a été soumis à des
mauvais traitements physiques et psychologiques. En revanche, à l’unanimité, la
Cour a conclu à une violation procédurale de l’article 3 : les plaintes du
requérant pouvaient être considérées comme des soupçons plausibles de mauvais
traitements, ce qui exigeait une enquête officielle effective. Si certaines
investigations furent menées, la Cour n’est cependant pas convaincue qu’elles
aient été suffisamment approfondies et effectives pour remplir l’exigence de
l’article 3 de la Convention. Certes, la limite de ce type d’approche, comme le
note Fl. Massias, pourrait être de mettre en place un système de violation à
deux vitesses : “ une qui qualifie et une autre qui évite la qualification ”.
Toutefois, bien utilisée, c’est-à-dire non pour abaisser le niveau d’exigence
d’un droit indérogeable mais pour accroître le niveau de protection, cette
approche peut trouver à s’appliquer lorsque le requérant est dans
l’impossibilité matérielle ou morale d’établir la réalité des faits qu’il
allègue. Dans certains cas, il peut courir des risques sérieux s’il dénonce les
traitements qu’il a subis ; dans d’autres, il ne peut établir ces faits sans la
coopération de l’État mis en cause ; dans d’autres encore, il peut être
incapable, en raison de son état mental, de décrire ce qu'il a subi ; enfin,
certains mauvais traitements, tels les insultes, les menaces ou les
humiliations, ne laissent pas de traces physiques se prêtant à un examen
médical. D’une certaine manière, comme le note G. Smaers, la composante négative
de l’article 3 (l’interdit) est étendue en une obligation positive de la part
des autorités, ce qui traduit aussi la subsidiarité du contrôle européen : il
appartient en premier lieu aux juridictions internes d’assurer le respect des
droits de l'Homme et, partant, d’apprécier les faits et de peser les éléments
recueillis. Ainsi que l’observe Fr. Sudre, il en résulte que l’article 3 impose
une double obligation, l’une substantielle, l’autre procédurale, même si le jeu
de cette dernière peut être limité par son absorption dans l’article 13 de la
Convention (le droit à un recours effectif).
En ce qui concerne la charge de
la preuve et, plus particulièrement le renversement de la charge de la preuve,
l’évolution amorcée se poursuit dans l’arrêt Satik et autres c/Turquie du
10 octobre 2000 (1ère section) où la Cour conclut à une violation substantielle
de l’article 3 de la Convention. En l’espèce, les requérants protestèrent contre
la fouille à laquelle voulaient procéder des employés de la prison alors qu’ils
attendaient d’être conduits à la Cour de sûreté de l’État pour y être jugés. Ils
soutiennent que l’administration de la prison demanda l’aide aux gendarmes qui
devaient les accompagner pendant le trajet et que ceux-ci, ainsi que les membres
du personnel de la prison, les agressèrent avec des matraques et des planches.
Le gouvernement soutient que les prisonniers, en résistant à la fouille,
tombèrent dans l’escalier et se blessèrent contre les murs, les marches et la
rampe. La Cour décide que le principe selon lequel il incombe à l’État de
fournir une explication plausible des blessures que présente une personne qui
était en bonne santé au moment de son arrestation, s’applique également dans le
contexte carcéral. A contrario, il revient donc à l’Etat concerné
d’apporter la preuve qu’il n’est pas responsable des blessures constatées, comme
la Cour le rappelle, avec un haut degré d’exigence, dans l’arrêt Caloc
c/France du 20 juillet 2000 (§ 92). En l’espèce, l’explication du
gouvernement s’accorde mal avec la nature des blessures consignées dans les
rapports médicaux. En outre, lorsque l’administration pénitentiaire sollicite
une aide extérieure pour faire face à un incident dans une prison, il doit
exister une forme de surveillance indépendante afin d’assurer que les auteurs du
recours à la force rendent compte de leurs actes. A cet égard, la Cour constate
qu’après une décision initiale de ne pas poursuivre, le dossier de l’affaire
disparut ; toutefois, quatre ans plus tard, en l’absence du dossier, les
autorités prirent la décision de ne pas poursuivre. La Cour estime que le fait
que les autorités n’aient pas veillé à ne pas perdre des pièces importantes du
dossier ne peut que passer pour une carence extrêmement grave de l’enquête et
l’absence de dossier fait douter du bien-fondé de la décision de ne pas
poursuivre qui a été prise en fin de compte. En l’absence d’explication
plausible de la part des autorités en ce qui concerne les blessures des
requérants, force est de conclure qu’ils ont été frappés par des agents de
l’État, comme ils l’allèguent. Ce traitement s’analyse en une violation de
l’article 3.
Enfin, quant au contenu de la
preuve et au niveau de celle-ci, dans l’arrêt Labita c/Italie du 4 avril
2000, la Cour exige que la preuve soit rapportée “ au-delà de tout doute
raisonnable ”. Dans l’arrêt Satik c/Turquie du 10 octobre 2000, la Cour
rappelle encore “ qu’elle adopte le critère de la preuve au-delà de tout doute
raisonnable ” mais elle ajoute “ qu’une telle preuve peut résulter de la
coexistence d’indices forts, clairs et concordants ainsi que de sérieuses
présomptions de fait ” (§ 55).
3 • Le droit à la liberté et
à la sûreté
L’article 5 de la Convention est
la seule disposition qui concerne de manière spécifique la détention. Elle est
structurée en trois parties : le principe, les exceptions, les garanties
procédurales.
A. Le principe : “ Nul ne
peut être privé de sa liberté ”
Différentes affaires pendantes
devant la Cour (Kelly c/Royaume-Uni, R. Smith c/Royaume-Uni, M.
Reilly et 7 autres requêtes c/Royaume-Uni, 3ème section) concernent, sous le
visa de l’article 5 § 1, un dispositif qui existe dans le Crime (Sentences)
Act 1997 selon lequel une peine de prison à vie sera (shall) imposée
à un adulte reconnu coupable d’une seconde infraction grave (“ two strikes you
are out ”), “ à moins que des circonstances exceptionnelles ” n’existent qui
justifient de ne pas imposer une telle peine. Une prison à vie dans ce contexte
signifie que l’auteur de l’infraction accomplit une période punitive (punitive
/ deterrent period) qualifiée de “ tariff ”, suivie par une période de
détention à durée indéterminée, qui se termine seulement lorsqu’il n’est plus
considéré comme étant un danger pour le public. Le détenu est alors libéré sous
condition (on licence) ce qui signifie que pour le reste de sa vie il est
susceptible de devoir réintégrer la prison sur décision du parole board,
s’il viole une des conditions qui ont été imposées à sa mise en liberté. Cette
disposition pose la question de la détermination de la peine et, partant, d’une
éventuelle privation arbitraire de liberté. En fait, soutient le requérant,
comme les circonstances exceptionnelles sont extrêmement rares, la peine
d’emprisonnement à vie devient en quelque sorte automatique, imposée sans
prendre en considération des questions telles que le délai qui a séparé les deux
infractions, l’âge du délinquant au moment de la première infraction, les
circonstances qui entourent la commission de l’infraction ou le caractère
proportionné de la peine d’emprisonnement à vie à l’infraction, au délinquant ou
à la situation. Cela pourrait conduire à une peine disproportionnée et, partant,
la section 2 de la loi de 1997 n’assurerait pas la protection garantie par
l’article 5 contre une privation arbitraire de liberté.
La requête Stafford
c/Royaume-Uni a fait l’objet d’une décision de dessaisissement en faveur de
la Grande Chambre (4 septembre 2001) et elle est donc actuellement pendante
devant la Cour. Le requérant avait été libéré “ on licence ” mais avait
été “ rappelé ” en prison pour subir une détention à vie en raison du fait qu’il
avait commis une nouvelle infraction, en l’espèce une fraude qui était sans
relation avec le risque d’une délinquance violente. D’autres requêtes (Wynne
c/Royaume-Uni ; Waite c/Royaume-Uni ; Waller et Vale c/Royaume-Uni)
sont en attente d’examen de la décision de la Grande Chambre.
B. Les exceptions
1) La détention après
condamnation (art. 5 § 1 a)
Il importe d’observer que la
Cour donne, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, une signification
autonome à la notion de détention après condamnation qui recouvre, en fait,
toutes les formes de privation de liberté dans le cadre du processus judiciaire.
Toutefois, le but de la détention doit être l’exécution d’une décision de
privation de liberté prise par un juge, même si la Cour ne se prononce pas sur
le but de la peine privative de liberté, son exigence portant sur le caractère
régulier de la détention.
Par ailleurs la notion de
détention après condamnation ne vise pas seulement un déroulement chronologique
mais également une relation entre la décision du juge et l’enfermement, en ce
sens qu’il doit “ exister un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué
pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de
détention ” (Aerts c/Belgique, 30 juillet 1998, § 46). En affirmant un
lien entre la privation de liberté et les modalités d’exécution de la peine, la
Cour reconnaît implicitement le droit à subir une détention dans un
établissement approprié. Ainsi, par exemple, la détention d’un malade mental
n’est légale que si elle est effectuée dans un hôpital ou une institution
appropriée. De manière plus générale, cette jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'Homme pose la question de l’application des peines. Dans la
mesure où l’on observe, dans certains pays, des commissions chargées de gérer
l’exécution des mesures et des sanctions pénales, le Conseil de l’Europe
pourrait favoriser le développement de ce type d’instance.
La requête Labita c/Italie,
déjà évoquée, posait aussi, sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, la
question du délai pour l’exécution d’une décision de mise en liberté. En
l’espèce, le requérant soutenait avoir subi une détention illégale pendant douze
heures après son acquittement. En concluant à la violation de cette disposition,
la Cour a estimé que le retard dans la libération du requérant n’a été provoqué
que partiellement par la nécessité d’accomplir les formalités administratives
dues à l’absence de l’employé du bureau de matricule. Dans ces circonstances, le
maintien en détention du requérant, après son retour à la prison, ne constituait
pas un “ début d’exécution ” de l’ordre de libération et ne relevait d’aucun des
alinéas de l’article 5 § 1 de la Convention.
Notons, enfin, que la Cour est
saisie, au titre de l’article 5 § 1 de la Convention, d’un grief qui fait valoir
une erreur de calcul des autorités judiciaires dans la détermination de la durée
d’une détention (Pezone c/Italie, décision de communiquer du 11 janvier
2000, 2ème section).
2) La détention provisoire (art.
5 § 1 c)
L’affaire Vittorino et Luigi
Mancini c/Italie concerne le retard dans leur transfert d’une prison, lieu
de détention provisoire, vers le domicile, lieu de l’assignation à résidence. En
l’espèce, estimant qu’il n’y avait pas de risque suffisant de récidive pour
justifier le maintien en détention provisoire, le juge décida d’y substituer une
mesure d’assignation à résidence. Le transfert de la prison dans laquelle les
requérants étaient détenus vers le lieu de leur assignation à résidence
s’effectua néanmoins avec un retard de plus de six jours. Compte tenu de leurs
effets et de leurs modalités, la Cour estime que la détention en prison comme
l’assignation à domicile constituait pour les requérants une privation de
liberté au sens de l’article 5 de la Convention. En ce qui concerne le problème
du retard pris par les autorités dans le remplacement de la détention carcérale
par une mesure de sûreté moins sévère, à savoir une assignation à résidence, la
Cour estime que cette affaire se distingue des autres affaires qui concernent le
retard dans la mise en liberté des requérants (§ 17). Par ailleurs, la Cour
considère “ que des différences importantes existent entre l’affaire Ashingdane
(Ashingdane c/Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985) et la présente affaire.
En effet, même s’il est vrai que dans certaines circonstances le transfert d’un
hôpital psychiatrique à un autre peut entraîner une amélioration significative
de la situation générale de l’intéressé, il n’en demeure pas moins qu’un tel
transfert n’implique aucune mutation du type de privation de liberté à laquelle
un requérant est soumis. Il en va autrement en ce qui concerne le remplacement
de la détention en prison par l’assignation à domicile, car dans ce cas il y a
modification de la nature du lieu de détention, qui passe d’un établissement
public à une habitation privée. A la différence de l’assignation à domicile, la
détention dans un pénitencier implique l’insertion dans une structure globale,
le partage des activités et des ressources avec d’autres détenus et un contrôle
rigide, de la part des autorités, des aspects principaux de la vie
quotidienne. ” (§ 19). Dès lors, la Cour “ estime que la situation dénoncée par
les requérants tombe dans le champ d’application de l’article 5 § 1 c) de la
Convention ” (§ 20). Quant au fond, “ la Cour rappelle que la liste des
exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère
exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette
disposition ” (§ 23). Si un certain délai dans l’exécution d’une décision de
remise en liberté est normal et souvent inévitable, les autorités doivent
cependant essayer de le réduire au maximum (§ 24). Dans ces conditions, le
retard dans le transfert des requérants de la prison où ils étaient détenus à
leur domicile n’est pas compatible avec l’article 5 de la Convention.
3) La détention d’un aliéné
(art. 5 § 1 e)
La requête J.M. c/Royaume-Uni,
actuellement pendante devant la Cour, soulève la question du maintien en
détention dans un hôpital psychiatrique, pendant un peu plus de trois ans, dans
les conditions suivantes. En 1995, le Mental Health Review Tribunal
estima que la requérante ne souffrait plus d’une maladie mentale exigeant sa
détention. Il assortit néanmoins son élargissement d’une condition relative au
lieu de sa résidence, qui devait être approuvée par le responsable médical et un
travailleur social. A défaut de remplir cette condition, sa libération
conditionnelle a été déférée jusqu’en 1998.
4) La détention d’un alcoolique
(art. 5 § 1 e)
Dans l’arrêt Varbanov
c/Bulgarie du 5 octobre 2000 (4ème section), la Cour a constaté une
violation de la Convention dans la situation suivante. Ayant reçu des plaintes
concernant le comportement menaçant du requérant, le procureur ordonna, après
une enquête, de le conduire de force dans un hôpital psychiatrique pour qu’il y
reste interné pendant vingt et un jours en vue d’un examen psychiatrique. La
Cour estime que la privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée
ne saurait être conforme à l’article 5 § 1 e) si elle a été ordonnée sans l’avis
d’un médecin. La forme et la procédure adoptées à cet égard peuvent varier selon
les circonstances ; dans les cas d’urgence, il se peut que cet avis ne soit
obtenu que juste après l’arrestation mais, dans tous les autres cas, il doit
l’être avant. Lorsqu’il n’est pas possible de faire autrement, par exemple
lorsque la personne concernée refuse de se prêter à l’examen, il faut au moins
qu’un médecin procède à une évaluation sur la base du dossier. De plus, cette
évaluation médicale doit porter sur l’état mental actuel de la personne
concernée et non pas seulement sur son passé. En l’espèce, le requérant a donc
été interné sans qu’un médecin ait été consulté. S’il est vrai que le but de
l’internement était de le faire examiner, une évaluation préalable de la part
d’un psychiatre, au moins sur base des documents disponibles, était à la fois
possible et indispensable. En effet, le requérant n’avait aucun antécédent
psychiatrique et personne n’a prétendu que l’affaire revêtait un caractère
d’urgence. Bien que le requérant ait été conduit dans un hôpital psychiatrique
où il a été examiné par des médecins, rien n’indique que l’on ait demandé à ces
derniers s’il fallait l’interner pour examen puisqu’un procureur avait déjà
décidé de le faire interner sans avoir pris d’avis médical. Il s’ensuit donc
qu’il n’a pas été prouvé de manière fiable que le requérant était aliéné. Il ne
s’agissait donc pas d’une détention régulière.
La requête Hutchison Reid
c/Royaume-Uni actuellement pendante devant la Cour concerne également le
maintien en détention dans un hôpital psychiatrique. En l’espèce, il fut établi
par les psychiatres que le requérant (qui avait été déclaré coupable de meurtre)
souffrait d’une déficience mentale exigeant son internement dans un hôpital
psychiatrique. Aux termes de la loi de 1984 sur la santé mentale, une personne
atteinte de troubles mentaux persistants caractérisés par un comportement
anormalement agressif ou gravement irresponsable doit être remise en liberté si
l’internement par un hôpital n’est pas propice à son traitement ou si le
traitement dispensé dans cet établissement n’est pas nécessaire à sa santé et à
sa sécurité ou à la protection d’autrui. En 1985, le requérant fut libéré sous
condition et transféré dans un hôpital ouvert. En 1986, il fut arrêté après
avoir tenté d’enlever un enfant. Il fut condamné à trois mois d’emprisonnement,
les psychiatres ayant estimé que son internement dans un hôpital psychiatrique
serait inefficace eu égard au caractère incurable de ses troubles de la
personnalité. Après avoir purgé sa peine, il fut renvoyé en hôpital
psychiatrique par le ministre, en application de la loi de 1984, sur
recommandation d’un médecin. Le requérant essaya d’obtenir une autorisation de
quitter l’hôpital, s’appuyant sur de nombreux rapports psychiatriques
établissant qu’il ne souffrait pas d’un trouble mental justifiant le maintien de
son internement en raison de son caractère incurable. En droit interne, son
recours fut rejeté, de même que sa demande consécutive du contrôle
juridictionnel.
Enfin, la requête Witold
Litwa c/Pologne qui a fait l’objet d’un jugement de la Cour le 4 avril 2000
(4ème section) précise que la détention d’un alcoolique, au sens de l’article 5
1 e) de la Convention vise, dans ce cas, les personnes dont le comportement
représente une menace.
C. Le contrôle judiciaire
Le droit à un contrôle
judiciaire porte, quant à lui, sur la régularité et la légalité de la détention
(art. 5 § 4). L’exigence d’un tel contrôle est aujourd’hui particulièrement
critique et sensible par rapport aux mesures de sûreté, souvent de durée
indéterminée, prises à l’endroit des récidivistes, des malades mentaux et des
mineurs ainsi que par rapport aux longues peines. La plupart de ces mesures ont
comme dénominateur commun la dangerosité de l’auteur des faits.
Les requêtes T. et V.
c/Royaume-Uni, qui ont fait l’objet de deux arrêts de la Grande Chambre du
16 décembre 1999, concernent la détention de deux mineurs condamnés “ pour la
durée qu’il plaira à Sa Majesté ”. En l’espèce, invoquant l’article 5 § 4 de la
Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas eu, à ce jour, la
possibilité de faire examiner la légalité de leur maintien en détention par un
organe judiciaire, tel que la Commission de libération conditionnelle. La Cour
constate que la période punitive (tariff) de la peine a été fixée par le
ministre de l’Intérieur, sans qu'aucun contrôle judiciaire ne se trouve
incorporé à la peine prononcée par le juge de première instance. Une fois la
période punitive purgée, les enfants qui sont détenus pour la durée qu’il plaira
à Sa Majesté doivent pouvoir, en vertu de l’article 5 § 4 de la Convention,
faire examiner, périodiquement, la question de leur dangerosité et donc la
légalité de leur maintien en détention par un organe judiciaire. Or, en
l’espèce, les requérants n’ont jamais eu cette possibilité puisque la décision
du ministre de l’Intérieur a été annulée par la Chambre des Lords et qu’aucune
période punitive n’a été fixée depuis lors. Comme les requérants n’ont pu faire
examiner la légalité de leur détention par un organe judiciaire depuis leur
condamnation en novembre 1993, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4
de la Convention.
Dans l’affaire Downing
c/Royaume-Uni, qui concernait également l’absence de contrôle d’une
détention “ pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté ” après l’expiration de la
période punitive (tariff), les parties sont parvenues à un règlement
amiable (arrêt du 6 juin 2000, 3ème section).
L'arrêt Curley c/Royaume-Uni
du 28 mars 2000 (3ème section) concerne cette fois le contrôle de la détention
par la Commission de libération conditionnelle. En l’espèce, le requérant fut
reconnu coupable, à l’âge de dix-sept ans, de meurtre et condamné à une peine
d’emprisonnement “ pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté ”. La période
punitive (tariff) de sa détention fut fixée à huit ans. Après celle-ci,
la Commission de libération conditionnelle procéda à plusieurs contrôles et
recommanda que l’intéressé fut libéré au bout d’un an. Le ministre ne suivit
toutefois pas cette recommandation mais le requérant se vit refuser
l’autorisation de demander le contrôle juridictionnel de la décision du
ministre. La Cour constate à l’unanimité une violation de l’article 5 § 4 de la
Convention : avant sa libération, qui est intervenue par après, le requérant
n’avait pas pu obtenir un contrôle d’un tribunal offrant les garanties
nécessaires puisque la Commission de libération conditionnelle n’avait pas la
compétence d’ordonner sa libération.
4 • Le droit à un procès
équitable
A. L’accès à un tribunal
La requête E.G. Walter
c/Autriche, actuellement pendante devant la Cour, concerne le droit d’accès
à un tribunal. En l’espèce, le requérant, qui était détenu au moment des faits,
se plaint qu’il a été empêché d’introduire, dans le délai requis, un droit de
réponse dans une revue qui avait publié un article le concernant, en raison des
lenteurs de l’administration pénitentiaire à poster son courrier.
B. Une accusation en matière
pénale
La Cour est actuellement saisie
de plusieurs requêtes concernant, au Royaume-Uni, les procédures
disciplinaires en prison (Clarke c/Royaume-Uni, Gaskin
c/Royaume-Uni, Whitfield c/Royaume-Uni).
Celles-ci constituent-elles une “ accusation en matière pénale ” au sens de
l’article 6 de la Convention, ouvrant le droit aux exigences du procès
équitable, notamment les droits de la défense ? Notons, en France, la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l’administration qui “ permet de faire rentrer l’avocat au prétoire de
discipline pour défendre les intérêts de son client poursuivi
disciplinairement ”.
Les affaires Ezeh et Connors
c/Royaume-Uni, qui constituent sans doute des leading cases, ont été
plaidées devant la Cour (3ème section) et elles ont fait l’objet d’une décision
de recevabilité du 30 janvier 2001. En l’espèce, le premier requérant a été
condamné, pour langage menaçant à l’endroit d’un agent de probation, à quarante
jours supplémentaires de détention, tandis que le second requérant, convaincu de
voies de fait contre un agent pénitentiaire, a été condamné à sept jours
supplémentaires. Dans les deux cas, aucun des deux requérants n’a été assisté
par un avocat lors de la procédure disciplinaire qui s’est déroulée devant le
directeur de la prison. L’application de l’article 6 de la Convention est donc
subordonnée aux critères traditionnellement utilisés par la Cour pour déterminer
la nature autonome de l’accusation en matière pénale, et notamment la
qualification en droit interne, la nature de l’infraction et la sévérité de la
peine. La question est toutefois plus complexe en raison de la nature même de
ces jours supplémentaires. En fait, les jours supplémentaires auxquels les deux
requérants ont été condamnés constituent des jours qui s’ajouteront à la peine à
partir du moment où le détenu peut être libéré. Alors qu’auparavant le détenu
bénéficiait seulement du privilège de rémission et pouvait être condamné à une
perte de rémission par le directeur de la prison, le Criminal Justice Act
de 1991 lui donne un droit à la libération à partir d’un certain seuil. Si la
libération peut être considérée comme un droit, les jours supplémentaires
auxquels les requérants ont été condamnés peuvent être considérés comme une
privation de liberté supplémentaire qui s’ajoute à la peine initiale. Dans ce
cas, il y aurait présomption que l’article 6 s’applique sauf si la peine en
l’espèce ne saurait “ causer un préjudice important ” (arrêt Engel et autres
c/Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82).
Concernant encore la
recevabilité ratione materiae, une nouvelle question se pose à la Cour et
elle concerne l’exécution de la peine et ses modalités. La jurisprudence
de la Cour est actuellement fixée en ce sens que les garanties de l’article 6
s’appliquent au sentencing stage de la procédure pénale mais non point à
la phase d’exécution de la peine. Néanmoins, des nouvelles requêtes entendent
aller plus loin et, sous le visa de l’article 6 § 1, se plaignent de l’absence
d’équité, de caractère contradictoire ou de publicité des procédures en matière
de libération conditionnelle, de permission de sortie, de libération sous
probation ou d’exécution de la peine selon un régime particulier. L’ensemble de
ces requêtes pose la question de savoir si les procédures concernant l’exécution
des peines, très largement judiciarisées aujourd’hui dans la plupart des pays du
Conseil de l’Europe, sont susceptibles de rentrer dans le champ d’application de
l’article 6 de la Convention.
C. Une cause entendue
publiquement
Dans la requête Riepan
c/Autriche, concernant un procès tenu dans l’enceinte d’une prison, la Cour
a conclu à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt du 14
novembre 2000, 3ème section). En l’espèce, le requérant purgeait une peine
d’emprisonnement pour meurtre et vol qualifié et, pendant sa détention, une
procédure pénale fut engagée contre lui pour menace grave à l’encontre du
personnel pénitentiaire. Aux termes de celle-ci, il fut condamné par le tribunal
régional qui avait siégé dans la prison elle-même. En appel, il fit valoir que
l’audience n’avait pas été publique puisqu’elle avait eu lieu dans la “ partie
fermée ” de la prison à laquelle les visiteurs n’ont accès que moyennant une
autorisation spéciale et qu’elle s’était tenue dans une pièce trop petite pour
accueillir un éventuel public. Après une audience publique qui s’est déroulée,
cette fois, dans les locaux de la cour d’appel elle-même, cette dernière écarta
le recours estimant que toute personne intéressée aurait été autorisée à
assister au procès.
Si la Cour s’est déjà penchée
sur l’exigence de publicité des audiences (notamment dans les matières du
contentieux disciplinaire, des recours en cassation ainsi que dans certaines
procédures propres aux Ordres des médecins), aucun de ses arrêts n’avait jusqu’à
présent abordé la question spécifique de la publicité dans les procédures
pénales ordinaires. Or, s'agissant du jugement de détenus considérés comme
dangereux, la question revêt dans de nombreux pays une certaine actualité.
La Cour rappelle les exigences
de la publicité des audiences, telles qu’elles résultent notamment de l’arrêt
Pretto et autres c/Italie du 8 décembre 1983 : “ La publicité de la
procédure des organes judiciaires visés à l’article 6 § 1 protège les
justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle
constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et
tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice,
elle aide à réaliser le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable, dont la
garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique
au sens de la Convention ” (§ 21). Certes, la publicité des audiences n’implique
pas nécessairement que celles-ci se déroulent dans un lieu ad hoc, tel
une cour ou un tribunal. Cependant, l’utilisation d’un autre lieu, et a
fortiori d’une prison, affaiblit le caractère public puisqu’elle accroît le
risque garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Pour respecter l’exigence
de publicité, la tenue du procès pénal dans un autre lieu doit dès lors
impliquer que des mesures soient prises pour compenser, le cas échéant, le
déficit de fait de la publicité des débats. Ces mesures pourraient consister,
par exemple, à assurer une accessibilité effective du public à la salle
d’audience ou encore à faire des démarches actives pour informer le public du
lieu et de la date des débats.
En l’espèce, la publicité
n’était pas officiellement exclue et ni le fait que le procès se déroulât dans
l’enceinte de la prison, ni le fait que les spectateurs éventuels auraient dû se
soumettre à des contrôles d’identité et de sécurité n’ont privé l’audience de
son caractère public. Mais il fallait toutefois, dans ce cas, que le public
puisse s’informer de la date et du lieu de l’audience et qu’il eût aisément
accès à celle-ci. La tenue d’une audience dans un endroit auquel le grand public
ne peut accéder constitue en soi un grave obstacle à la publicité et met l’État
dans l’obligation de prendre des mesures de manière à ce que le public et les
médias soient dûment informés et bénéficient d’un accès effectif. En l’espèce,
hormis l’annonce habituelle de l’audience, aucune mesure particulière ne fut
adoptée. En outre, les conditions dans lesquelles l’audience allait se dérouler
n’incitaient guère le public à y assister. Dès lors, la Cour estime que
l’audience ne répondait pas à la condition de publicité.
Quant à la question de savoir si
l’absence de publicité pouvait se justifier, celle-ci pose la question des
limitations : les limitations aux exigences de publicité sont-elles justifiées
par des raisons de sécurité ? Certes, dans l’arrêt Campbell et Fell
c/Royaume-Uni du 28 juin 1984, la Cour a estimé que le transport des
inculpés hors de la prison “ imposa aux autorités de l’État un fardeau
disproportionné ” (§ 86). Toutefois, il s’agissait dans ce cas d’une juridiction
disciplinaire qui exerce d’habitude ses attributions contentieuses à l’intérieur
de la prison, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La Cour a estimé que si les
questions de sécurité suscitaient apparemment des préoccupations, ni le tribunal
saisi en première instance, ni la cour d’appel, ne les considérèrent comme assez
vives pour commander une décision formelle excluant le public. Il en résulte dès
lors que l’absence d’audience publique ne trouvait pas, en l’espèce, de
justification suffisante.
Enfin, quant au point de savoir
si l’audience devant la Cour d’appel a pu remédier à l’absence de publicité en
première instance, eu égard notamment aux effets préjudiciables que cette
absence de publicité a pu avoir sur l’équité de la procédure, seul un réexamen
exhaustif de la cause en degré d’appel était susceptible d’y remédier. Or
l’examen auquel se livra la Cour d’appel n’eut pas l’ampleur requise : si cette
juridiction a pu réexaminer les questions de droit et de fait et apprécier à
nouveau l’opportunité de la peine, elle n’a pas entendu de témoignage et n’a pas
procédé à une nouvelle instruction de l’affaire. Dans ces conditions, la Cour
estime qu’il n’a pas été remédié en appel à l’absence d’audience publique.
D. Un tribunal indépendant et
impartial
Dans les mêmes arrêts T. et
V. c/le Royaume-Uni du 16 décembre 1999, la période punitive (tariff)
imposée à un délinquant juvénile détenu pour la durée qu’il plaira à sa Majesté
représente la période maximale à purger pour répondre aux impératifs de la
répression et de la dissuasion. Après cette période, l’intéressé doit être
libéré sauf s’il y a des raisons de croire qu’il est dangereux. La Cour estime,
ainsi que l’a reconnu elle-même la Chambre des Lords dans le cadre de la
procédure de contrôle juridictionnel engagée par le requérant, que la fixation
de la période punitive équivaut au prononcé d’une peine. Comme le ministre de
l’Intérieur qui a décidé de la période punitive n’est manifestement pas
indépendant de l’Exécutif, la Cour constate qu’il y a violation de l’article 6 §
1 d la Convention quant à la détermination de la peine des requérants.
E. Les facilités nécessaires
à la préparation de la défense
Dans l’affaire Lanz
c/Autriche (décision du 30 janvier 2001, 3ème section), le requérant se
plaignait que les contacts avec ses avocats avaient été soumis à surveillance,
pendant deux mois, par le juge d’instruction. Rattachant ce grief à l’article 6
§ 3 b) de la Convention, la Cour rappelle que le droit d’un accusé de
communiquer librement avec son avocat, sans la présence d’un tiers, fait partie
des exigences fondamentales du procès équitable dans une société. Si l’avocat ne
peut s’entretenir avec son client ni recevoir des informations ou des
instructions confidentielles, son assistance perd une grande partie de son
effectivité. Les raisons invoquées en l’espèce, le risque d’influencer les
témoins ou de voir disparaître les documents, n’ont pas paru suffisantes pour
justifier la mesure : en raison de la gravité de l’interférence dans l’exercice
des droits de la défense, des raisons d’égale gravité doivent la justifier.
5 • Le droit au respect de sa
vie privée et familiale et de sa correspondance
A. La vie privée et familiale
En ce qui concerne le droit au
respect de la vie privée et familiale des détenus, la jurisprudence de la
Commission, notamment celle développée dans l’affaire X. c/Royaume-Uni
(décision du 8 octobre 1982), “ fait son entrée ” dans la jurisprudence de la
Cour.
Ce droit implique pour les détenus le maintien de contacts avec le monde
extérieur en vue de leur réintégration dans la société. Ainsi, dans l’arrêt
Messina c/Italie (n° 2) du 28 septembre 2000 (2ème section), le requérant
condamné pour association de type mafieux et trafic de stupéfiants se plaignait
d’une atteinte à l’article 8 de la Convention en raison des restrictions du
nombre de visites (deux fois par mois) et des modalités de celles-ci (par voie
vitrée). La Cour rappelle “ que toute détention régulière au regard de l’article
5 de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et
familiale de l’intéressé. Il est cependant essentiel au respect de la vie
familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un
contact avec sa famille proche ” (§ 61). Les restrictions apportées à ce droit
constituent des ingérences qui doivent dès lors répondre à un besoin social
impérieux et être proportionnées au but légitime poursuivi afin d’assurer un
juste équilibre entre les exigences du maintien des liens familiaux et celles de
l’intérêt général. Tel était le cas, en l’espèce, aux yeux de la Cour qui n’a
pas constaté une violation de l’article 8 de la Convention.
Dans la requête Kalashnikov
c/Russie qui a été plaidée devant la Cour (3ème section) le 18 septembre
2001, le requérant soulève, parmi d’autres, un grief du même ordre, dans la
mesure où il soutient qu’il n’aurait pas été autorisé à voir sa femme et ses
enfants depuis son placement en détention. Dans la décision partielle de
recevabilité du 18 septembre 2001, la Cour rappelle l’obligation qui pèse sur
les autorités pénitentiaires d’aider les détenus à maintenir des contacts
effectifs avec les membres de leur famille, même si dans les circonstances de
l’espèce elle estime que la restriction des contacts est proportionnée au but
poursuivi. Dans cette même décision, il est important de signaler, en ce qui
concerne la question des visites conjugales, que la Cour note avec
intérêt le mouvement de réforme dans différents pays européens qui vise à
améliorer les conditions de détention facilitant de telles visites. Elle
considère cependant, dans l’état actuel des choses, que le refus de telles
visites peut être considéré comme justifié.
B. La vie privée
La requête R.R. Allan
c/Royaume-Uni, qui a fait l’objet d’une décision partielle de recevabilité
du 28 août 2001, soulève une question nouvelle. En l’espèce, les autorités
pénitentiaires avaient installé du matériel d’enregistrement des conversations
et de surveillance vidéo dans les cellules d’un détenu et d’un codétenu aux fins
d’obtenir des informations susceptibles d’apporter la preuve des infractions
dont ils étaient soupçonnés. Le gouvernement a concédé, au regard des articles 8
et 13 de la Convention, que pareilles interférences dans la vie privée n’étaient
pas prévues par la loi et qu’il n’existait pas de recours effectif en cette
matière. Le prolongement de cette affaire soulève une question au regard de
l’article 6 de la Convention : dans quelle mesure une preuve obtenue en
violation de l’article 8 de la Convention rend-elle le procès inéquitable ?
C. La correspondance
Enfin, au regard de l’article 8
de la Convention, un nombre relativement important d’affaires, ces deux
dernières années, concernent le contrôle de la correspondance des détenus,
notamment avec les organes de la Convention. A cet égard, il est intéressant de
noter les dispositions contenues dans l’Accord européen concernant les personnes
participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l'Homme.
L’article 3 § 2 dispose que, en ce qui concerne les personnes détenues,
l’exercice du droit de correspondre librement avec la Cour implique notamment
que : “ leur correspondance doit être transmise et leur être remise sans délai
excessif et sans altération ; ces personnes ne peuvent faire l’objet d’aucune
mesure disciplinaire du fait d’une communication transmise à la Cour par les
voies appropriées ; ces personnes ont le droit, au sujet d’une requête à la Cour
et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à
plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues et de s’entretenir
avec lui sans pouvoir être entendu par quiconque d’autre ”.
A cet égard, il convient d’observer que, dans certains cas, une ingérence dans
la correspondance avec la Cour peut poser un problème non seulement au regard de
l’article 8 mais aussi de l’article 34 de la Convention (Klyakhin c/Russie,
décision du 3 avril 2001, 3ème section).
D’emblée, il importe évidemment
de rappeler l’enseignement de l’arrêt Golder c/Royaume-Uni du 21 février
1975 : la détention implique comme seule privation celle de la liberté physique.
Toutes les autres limitations doivent être soumises aux conditions de mise en
œuvre des exceptions prévues à l’article 8 § 2 de la Convention, à savoir
légalité, légitimité et proportionnalité. Toutefois, les conditions de détention
ne sont pas irrelevantes en ce qui concerne les limitations apportées aux droits
fondamentaux. Ainsi, en ce qui concerne le contrôle de la correspondance, la
Cour a estimé qu’il fallait tenir compte des exigences “ normales et
raisonnables de l’emprisonnement ” (arrêt Campbell c/Royaume-Uni, 25 mars
1992, § 45). Une position de cet ordre doit cependant, à mon sens, être
elle-même limitée. Elle ne pourrait aboutir à ce que, s’agissant de personnes
détenues, d’autres critères que ceux appliqués aux citoyens libres soient pris
en compte. En effet, cela amènerait la Cour à réintroduire des limitations
inhérentes au régime de détention.
1) Une ingérence
Dans la requête Touroude
c/France, la Cour a pris une décision d’irrecevabilité (3 octobre 2000, 3ème
section). En l’espèce, le requérant n’a en effet produit qu’une seule enveloppe,
effectivement ouverte par les autorités pénitentiaires, pour étayer ses
allégations sur l’existence de violations répétées du secret des
correspondances. Certes, le secrétariat de la Commission et le greffe de la Cour
faisant partie, d’après la législation interne, des autorités avec lesquelles le
détenu peut correspondre, sous pli fermé, l’ouverture d’une de ses
correspondances est contraire à la loi. Il en résulte dès lors que les
communications entre les détenus et la Cour doivent être exemptées de toute
restriction inutile. Toutefois, sur la quarantaine de correspondances échangées
entre le requérant et la Cour, une seule de ses lettres a été ouverte “ par
erreur ” et dans un établissement où le requérant venait d’être transféré. Il
n’existe donc pas d’élément permettant de conclure à une volonté des autorités
de s’immiscer dans les échanges entre le requérant et les organes de la
Convention, ni à un dysfonctionnement du service du courrier susceptible d’être
analysé, sans conteste, comme une ingérence dans le droit au respect de sa
correspondance.
2) Prévue par la loi
Les différentes affaires
signalées ici concernent des régimes particuliers de détention justifiés
notamment par l’appartenance supposée des requérants à des groupes mafieux.
Dans l’affaire Labita
c/Italie, que j’ai déjà évoquée dans le contexte de l’article 3 et de
l’article 5 § 1, le requérant se plaignait également de la censure de sa
correspondance. La Cour conclut à la violation de l’article 8 dans la mesure où,
selon les différents moments où le grief était allégué, un tel contrôle n’était
pas fondé sur des dispositions légales pertinentes - donc n’était pas prévu par
la loi - et était dépourvu de toute base légale.
Dans l’affaire Messina
c/Italie (n°2) du 28 septembre 2000 (2ème section), déjà évoquée, qui
concernait également l’implication du requérant dans des activités de type
mafieux, la censure systématique de la correspondance par les autorités
carcérales, en ce compris les lettres adressées à la Commission européenne des
droits de l'Homme parvenues avec un visa de censure, a entraîné une violation de
l’article 8 de la Convention pour les mêmes motifs (§ 83).
Deux autres affaires concernent,
toujours en Italie, le régime spécial de détention pour les détenus ayant été
condamnés pour des infractions graves. Dans l’arrêt Natoli c/Italie du 9
janvier 2001 (1ère section), la Cour conclut à l’unanimité à la violation de
l’article 8 de la Convention. En l’espèce, le requérant incarcéré depuis 1984
purgeait une peine de prison à perpétuité. En juillet 1992, le ministre de la
Justice prit un arrêté imposant, pour un an, l’application d’un régime spécial
de détention prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’administration
pénitentiaire. Sur cette base, la correspondance du requérant fut censurée et
toute correspondance avec d’autres détenus fut interdite. Ce régime spécial de
détention fut prorogé de six mois en six mois jusqu’en février 1997. Si
l’interdiction de correspondre avec d’autres détenus fut abandonnée, en revanche
la censure de la correspondance fut maintenue et des courriers adressés à la
Commission européenne des droits de l'Homme ainsi qu’aux avocats du requérant
attestent de cette censure. La Cour constate que pendant la période initiale
d’application du régime spécial de détention (de juillet 1992 à janvier 1994),
“ le contrôle de la correspondance du requérant se fondait sur l’arrêté du
ministre de la Justice pris en application de l’article 41 bis de la loi sur
l’administration pénitentiaire ” (§ 42). Or, par des arrêts de 1993, la Cour
constitutionnelle italienne estima que le ministre de la Justice avait
outrepassé ses compétences en prenant des mesures concernant la correspondance.
Partant, la Cour estime que le contrôle de la correspondance du requérant
pendant cette période n’était pas prévu par la loi. S’agissant de la période
postérieure, le contrôle de la correspondance a été ordonné par le juge
d’application des peines qui se fondait sur l’article 18 de la loi sur
l’administration pénitentiaire. Or, dans les arrêts Calogero Diana c/Italie
et Domenichini c/Italie du 15 novembre 1996, la Cour a estimé que cet
article n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités
d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes. En outre, le
projet de loi présenté au Sénat visant une modification législative en vue de se
conformer à ces arrêts ne semble pas avoir abouti. S’il est vrai que le nouveau
règlement des établissements pénitentiaires entré en vigueur le 6 septembre 2000
prévoit l’interdiction de censurer le courrier adressé à la Cour, cette
modification législative ne touche pas l’article 18 de la loi sur
l’administration pénitentiaire, une disposition qui est jugée comme constituant
une base légale insuffisante. En conclusion, l’ingérence dans le droit pour le
requérant au respect de sa correspondance n’était pas “ prévue par la loi ” au
sens de l’article 8 de la Convention, conclusion qui rend superflu de vérifier,
en l’espèce, le respect des autres exigences de l’article 8 § 2 (voy. aussi dans
une situation quasi identique et dans le même sens l’arrêt Rinzivillo
c/Italie du 21 décembre 2000, 2ème section, et l’arrêt Di Giovine
c/Italie du 26 juillet 2001, 4ème section).
Dans la requête Demirtepe
c/France (arrêt du 21 décembre 1999, 3ème section), le requérant qui
purgeait comme condamné une peine d’emprisonnement, déposa plainte contre les
autorités pénitentiaires pour violation du secret de la correspondance. Il
soutenait que les courriers adressés par ses avocats aux autorités judiciaires
ou à l’aumônier de la prison lui parvenaient ouverts. Saisi de la plainte, le
juge d’instruction conclut qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre. Tout en
considérant que l’élément matériel du délit était constitué, la Cour d’appel
rejeta le recours du requérant en estimant qu’elle ne pouvait retenir une
responsabilité collective du service du courrier de la maison d’arrêt, ni la
responsabilité pénale de celui qui assumait la responsabilité du service. Quant
à l’exception préliminaire du gouvernement, la Cour estime que les voies de
recours internes ont été épuisées. D’une part, le gouvernement ne démontre pas
en quoi la voie pénale choisie par le requérant n’était pas susceptible
d’assurer une réparation de la violation constatée. D’autre part, en ce qui
concerne le recours ouvert au requérant devant les juridictions administratives,
la preuve de son efficacité n’a pas été apportée dans la mesure où les jugements
des tribunaux administratifs portant sur le respect de la correspondance des
détenus datent de 1997 alors que les griefs formulés par le requérant remontent
à 1993. En outre, le Conseil d’État ne s’est jamais prononcé sur ce point. Quant
au fond, l’ouverture de la correspondance du requérant constitue bien, dans les
circonstances de l’espèce, une ingérence dans son droit au respect de sa
correspondance. Comme le reconnaît d’ailleurs le gouvernement lui-même, cette
ingérence est dépourvue de fondement légal et elle est, dès lors, injustifiée.
La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 de la Convention.
3) Nécessaire dans une société
démocratique
Dans l’arrêt Peers c/Grèce
du 19 avril 2001, la Cour conclut également à la violation de la Convention. Si
la Cour admet que la censure de la correspondance du requérant avec les organes
de la Convention était prévue par le Code pénitentiaire et poursuivait un but
légitime, elle estime que les raisons invoquées - le risque d’introduire de la
drogue dans la prison - ne sont pas suffisantes pour justifier l’ingérence (§§
82-84).
Dans la requête Slavgorodski
c/Estonie, un accord amiable est intervenu entre les parties (arrêt de
radiation du rôle du 12 septembre 2000, 2ème section). Le requérant avait été
condamné à une peine d’emprisonnement pour meurtre et, au cours de sa détention,
les autorités pénitentiaires ouvrirent régulièrement sa correspondance, dont la
remise fut retardée. L’intéressé faisait en particulier état de lettres du
ministère de l’Intérieur, du parquet, du président et d’organisations
internationales, dont la Commission européenne des droits de l'Homme, lettres
qu’il a reçues ouvertes. Les parties sont parvenues à un règlement aux termes
duquel le gouvernement exprime ses regrets pour l’ouverture de la correspondance
avec la Commission et déclare, en outre, que l’arrêt de la Cour rayant l’affaire
du rôle sera communiqué au président d’Estonie, au ministre de la Justice et aux
autres autorités concernées.
Enfin, dans l’arrêt Valasinas
c/Lituanie du 24 juillet 2001, la Cour constate que le gouvernement n’a
fourni aucune raison qui pourrait justifier le contrôle de la correspondance du
requérant avec la Cour, dont la confidentialité doit être respectée. Elle estime
dès lors que pareille ingérence n’était pas nécessaire dans une société
démocratique au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (§ 129).
6 • Le droit à un recours
effectif
Dans la requête Keenan
c/Royaume Uni (arrêt du 3 avril 2001, 3ème section), une double question se
posait quant au grief de l’absence de recours effectif garanti par l’article 13
de la Convention. D’une part, le jeune détenu, qui s’est suicidé alors qu’il
avait été placé en isolement cellulaire, disposait-il lui-même d’un recours en
droit interne pour contester, notamment en raison de son état mental, un tel
placement ? Alors que la décision disciplinaire prononcée révèle une violation
de l’article 3 de la Convention, la Cour constate l’absence de tout recours
susceptible de mettre en cause, voire d’annuler cette décision et elle conclut
dès lors à une violation de l’article 13 de la Convention (§ 126). D’autre part,
après son suicide, sa mère qui est la requérante devant la Cour disposait-elle
d’un recours ? La Cour conclut aussi à la violation de l’article 13 en observant
l’absence de recours compensatoire et surtout de recours susceptible d’établir
la responsabilité, élément essentiel de réparation pour un parent en deuil (§§
131-132).
La requête Younger c/le
Royaume-Uni, actuellement pendante devant la Cour, soulève un grief du même
ordre.
Enfin, dans la requête
Shepelev c/Russie, également pendante devant la Cour, la question qui est
notamment posée est celle de l’existence d’un recours effectif devant une
autorité nationale contre les conditions précaires de détention.
7 • Le droit à des élections
libres et la liberté de circulation
Dans l’affaire Labita
c/Italie (arrêt du 6 avril 2000, Grande Chambre), déjà souvent évoquée, un
dernier grief portait sur le fait que, après l’acquittement, des mesures de
sûreté qui avaient été ordonnées pendant la détention furent appliquées pendant
trois ans (couvre-feu, interdiction de quitter le domicile sans en informer les
autorités de tutelle, obligation de se présenter toutes les semaines à la
police, interdiction de fréquenter les bars ou les réunions publiques ou de
s’associer avec des personnes ayant des antécédents judiciaires). Le requérant
fut en outre assigné à résidence et ses tentatives pour faire lever ces mesures
sont restées vaines au motif que, si les preuves étaient insuffisantes pour le
condamner, il y en avait assez pour justifier des mesures de sûreté. Ces mesures
privèrent également le requérant de son droit de vote.
La Cour conclut à l’unanimité à
la violation de l’article 2 du Protocole n° 4. Le requérant a subi des
restrictions très lourdes à sa liberté de circulation, qui s’analysent en une
ingérence dans ses droits garantis par cette disposition. Certes, ces mesures
étaient prévues par la loi et elles poursuivaient des buts légitimes, à savoir
le maintien de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Si des
éléments concrets recueillis au cours du procès, bien qu’insuffisants pour
parvenir à une condamnation, peuvent néanmoins justifier les craintes
raisonnables que l’individu concerné puisse à l’avenir commettre des infractions
pénales, les motifs invoqués pour refuser de révoquer cette mesure après
l’acquittement ne permettent pas de conclure que les restrictions étaient
justifiées. Elles ne pouvaient dès lors être considérées comme nécessaires.
Quant à l’article 3 du Protocole
n° 1, la Cour ne saurait douter que la suspension temporaire du droit de vote
d’une personne sur qui pèsent des indices d’appartenance à la mafia poursuit un
but légitime. Elle ne partage toutefois pas l’opinion du gouvernement selon
laquelle les graves indices de la culpabilité du requérant n’avaient pas été
démentis au cours du procès. Au moment de la radiation du requérant des listes
électorales, il n’existait aucun élément concret permettant de le soupçonner
d’appartenir à la mafia et la mesure ne peut donc être considérée comme
proportionnée. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention.
Conclusion
Que pouvons-nous conclure,
provisoirement, de ces rendez-vous des droits de l'Homme et de la prison ? Quels
jalons poser ? Les situations se multiplient, se complexifient aussi. De
nouveaux problèmes se posent, en relation avec l’usage accru des mesures et des
sanctions dans un climat pénal marqué, depuis quelques années et de manière
relativement convergente dans de nombreux pays, par le redéploiement de la
sécurité et de la dangerosité, souvent dans un contexte d’urgence, ce qui à son
tour invite à une réflexion renouvelée sur la place de la peine de prison et les
fonctions qu’elle remplit.
La tâche de la Cour européenne
des droits de l'Homme est donc de poursuivre, dans le champ clos de la prison,
le contrôle rigoureux et continu des droits qui sont garantis par la Convention,
à toute personne car les droits de l'Homme ne sont jamais “ acquis ”. Ils sont
toujours à construire au plus près, au plus juste. Leur nature est de nous
inviter à une vigilance constante, individuelle et collective.
|