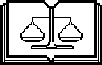|
L'équité de la procédure en
matière administrative
Le rôle du Commissaire du
gouvernement
devant le Conseil d'Etat
(arrêt Kress du 7 juin 2001)
par
François-Guilhem BERTRAND
Professeur à l'Université de
Paris XI
Ce début d’après-midi sonne
l’heure de l’arrêt Kress : craint ou attendu, en tout cas, commenté,
analysé, soupesé dans ses termes, dans ses perspectives et dans l’opinion
partiellement dissidente commune à sept des juges de la grande chambre, y
compris son président. ("Le commissaire du gouvernement et les exigences du
procès équitable (l’arrêt Kress de la Cour européenne des droits de l’Homme du 7
juin 2001", RFDA, 2001, p. 991, dossier comprenant le texte de
l’essentiel de l’arrêt, l’opinion partiellement dissidente, avec deux
commentaires : B. Genevois, "Réconfortant et déconcertant", ibid., p.
991 ; J.I. Autin et F. Sudre, "Juridiquement fragile, stratégiquement correct",
ibid., p. 1000 ; J. Andriantsimbazovina, D., 2001, chron. p. 1188
(chronique publiée quelques jours avant l’arrêt Kress) ; J.
Andriantsimbazovina, "Savoir n’est rien, imaginer est tout, libre conversation
autour de l’arrêt Kress de la Cour européenne des droits de l’Homme",
D., 2001, chron., p. 2611 ; D. Chabanol, "Théorie de l’apparence ou
apparence de théorie ? Humeurs autour de l’arrêt Kress", AJDA,
2002, p. 9 ; R. Drago, "Le Conseil d’Etat français et la Convention européenne
des droits de l’Homme", D., 2001, J, p. 2619 ; J.-F. Flauss, "La double
lecture de l’arrêt Kressc/France, Les petites affiches, 2001, n°
197, p. 13 ; Ch. Maubernard, "L’arrêt Kress c/France de la Cour
européenne des droits de l’Homme : le rôle du commissaire du gouvernement près
du Conseil d’Etat à la lumière de la théorie des “ apparences", R.D.P.,
2001, chron. adm. p. 895 ; F. Rolin, "Le rôle du Commissaire du gouvernement du
Conseil d’Etat au regard de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits
de l’Homme", AJDA, 2001, p. 675 ; F. Sudre, "La compatibilité de
l’institution du commissaire du gouvernement près le Conseil d’Etat à l’article
6 de la Convention européenne des droits de l’Homme : l’arrêt Kress c/France
ou le triomphe des “ apparences", JCP, 2001 II 10578).
La procédure administrative
française qui va aboutir à notre arrêt a duré une dizaine d’années, depuis
l’accident vasculaire subi par Mme Kress le 8 avril 1986 au cours d’une
intervention chirurgicale à Strasbourg jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat du 30
juillet 1997.
Mme Kress ayant reçu réparation
en 1991 pour une brûlure à l’épaule occasionnée par une tasse de thé verra
cependant l’essentiel de sa demande rejetée aussi bien en première instance
qu’en appel ou en cassation.
Devant ces échecs répétés le
conseil de Mme Kress va songer à mettre en cause, outre la durée excessive de la
procédure, le rôle du commissaire du gouvernement devant la Haute Assemblée en
avançant le non respect de l’exigence du procès équitable et le principe de
l’égalité des armes.
En l’espèce, la violation de
l’article 6-1 de la Convention résulterait, selon la requérante, de trois
éléments distincts :
- défaut de communication des
conclusions avant l’audience ;
- impossibilité de répliquer au
commissaire du gouvernement qui parle en dernier lieu à l’audience ;
- assistance du commissaire du
gouvernement au délibéré quand bien même il ne vote pas.
Les deux premiers griefs sont
rejetés par la Cour de Strasbourg qui va, en revanche, considérer qu’il y a
violation de la Convention du fait de la participation du commissaire du
gouvernement au délibéré de la formation du jugement.
Elle admettra par ailleurs que
la durée de la procédure n’a pas été raisonnable.
C’est la sensibilité accrue du
public aux garanties d’une bonne justice justifiant l’importance croissante
attribuée aux apparences qui justifie la décision de la Cour en ce qui concerne
la participation du commissaire du gouvernement au délibéré.
Ce raisonnement est très
vivement critiqué sur ce point par les sept juges ayant émis une opinion commune
partiellement dissidente.
Un arrêt réconfortant selon B.
Genevois car il sauve l’essentiel de l’institution, mais un arrêt déconcertant,
toujours selon B. Genevois, car il ébranle, sans grande justification, une
“ institution respectée et reconnue depuis un siècle et demi ” (selon l’opinion
commune partiellement dissidente).
Il nous paraît surtout qu’après
avoir marqué un certain progrès dans la connaissance du fonctionnement de la
juridiction administrative (I) , l’arrêt masque derrière cette apparence une
incompréhension radicale de l’institution (II)
I • Un progrès dans la connaissance du fonctionnement de la
juridiction administrative
A • De l’arrêt
Borgers (1961) à l’arrêt
Kress (2001)
Pourquoi la juridiction
européenne s’intéresse-t-elle au fonctionnement des juridictions ?
En soi, l’interrogation est
légitime, le droit au juge doit être apprécié dans son fonctionnement concret,
l’effectivité et l’efficacité des procédures doivent être prises en compte au
regard des exigences des articles 6 et 13 de la Convention ; la Cour de
Strasbourg est dans son rôle lorsqu’elle entend le vérifier.
Cela étant, son rôle devient
discutable et “sujet à caution” lorsqu’elle entend privilégier un type de juge
et opposer deux systèmes qui ont chacun leurs justifications et leurs faiblesses
mais qu’il ne faut certes pas juger ni rejeter ou adopter globalement.
A défaut, la jurisprudence de la
Cour donne une apparence d’incertitude qui va à l’encontre de son rôle.
Ainsi, le raisonnement mené dans
l’arrêt Reinhard et Slimane Kaïd (31 mars 1998) se trouve infirmé dans
l’arrêt Morel (6 juin 2000) commenté par M.L. Niboyet l'an dernier (cf.
Cahier du CREDHO, n° 7/2000).
Le rapporteur, le juge
commissaire sont des institutions spécifiques à un système juridictionnel où le
juge participe à l’instruction ce qui n’est pas le cas des juridictions
anglo-saxonnes.
Mais on observera que la
pratique de l’opinion dissidente est plus déroutante encore.
Plutôt que de condamner de
manière abstraite il paraît plus conforme à l’esprit de la Convention de
vérifier concrètement les garanties qu’offrent les différents systèmes et de
proposer des solutions propres à les améliorer.
En ce sens, les arrêts rendus
par la Cour de Strasbourg depuis dix ans témoignent avec des hésitations et des
incertitudes propres à tout organisme collégial d’une certaine prise en compte
de la réalité des juridictions
B • Le rôle du commissaire du
gouvernement
En dépit d’une littérature
abondante, le rôle du commissaire du gouvernement n’est pas dégagé avec
certitude dans ses origines.
Un ministère public, un juge
détaché pour certains, il constituerait même une partie jointe ; Tony Sauvel, R.
Guillien et les auteurs qui se penchent sur l’institution ne sont d’accord que
sur son indépendance que les affaires Reverchon et Gervaise
permettront de dégager.
En réalité, il s’agit d’une
institution spécifique qui comme la juridiction administrative elle-même, est à
l’origine de résultats suffisamment féconds pour qu’on ne la détruise pas au nom
d’un juridisme abstrait (conclusions Rougevin-Baville sous CE, 25 janvier 1980,
Gadiaga et autres, Rec., p. 44).
C’est à cette approche que se
sont ralliés les sept juges dans leur opinion commune partiellement dissidente :
la Cour aurait dû “ laisser intacte une institution respectée et reconnue depuis
plus d’un siècle et demi ”.
Au fond en sauvant
l’institution elle-même, mais en la privant d’une partie de ses prérogatives :
assister au délibéré, la Cour reconnaît l’institution tout en l’affaiblissant.
“ La légère meurtrissure (…) d’une marche invisible et sûre, en a fait lentement
le tour (…) n’y touchez pas, il est brisé ” (Sully Prud’homme).
Etranger aux parties mais jouant
un rôle dans la partie, son rôle essentiel est sauvegardé, mais son rôle plein
et entier est irrémédiablement affecté.
II • L’arrêt masque une incompréhension radicale
A • Les deux conceptions du juge arbitre
Juge arbitre, soit, mais quel
arbitre ? Celui qui dirige dès le début, oriente et intervient dans le débat
pour le réguler et éventuellement rétablir un équilibre rompu, ou bien celui qui
bien qu’absent des débats garde sa faculté de trancher car il reste en dehors ?
Un juge qui peut parler avant la
décision et auquel on pourra répliquer par une note en délibéré dont le Conseil
d’Etat admet maintenant la possibilité par un arrêt rendu un mois après l’arrêt
Kress (CE, 12 juillet 2001, Einhorn).
La Cour est ainsi entendue dans
ce que sa décision sur la réalité de la pratique de la note en délibéré avait de
plus hypothétique…
Sans reprendre la notion d’allié
objectif d’une des parties, comme elle l’avait fait dans l’arrêt Reinhard et
Slimane Kaïd, la Cour pousse le plus loin possible l’exigence du
contradictoire mais écarte le commissaire du gouvernement du délibéré car ayant
parlé, ayant donné son opinion, sa présence va peser sur la discussion des
autres juges même si l’on admet qu’il y assiste sans y prendre part.
B • Le commissaire du
gouvernement exclu du délibéré
En se fiant à l’apparence, la
Cour a éludé le véritable problème posé par ce juge qui parle.
Certes, comme le rappellent les
juges dissidents, l’institution est respectée et reconnue, et il est encore vrai
de dire que si le commissaire du gouvernement a une opinion et l’exprime, il n’a
pas pour autant manqué à son devoir d’objectivité dans l’examen personnel qu’il
a fait du dossier et qui l’a conduit à sa prise de position.
Cela étant, la Cour semble avoir
oublié que le commissaire du gouvernement peut peser sur le délibéré du Conseil
d’Etat d’une façon très directe et importante.
L’article R 122-17 du Code de la
juridiction administrative porte que le commissaire du gouvernement peut
demander avant l’audience, ou même au cours du délibéré, que le jugement de
l’affaire soit renvoyé à une autre formation de jugement.
La décision de renvoi peut peser
de façon décisive sur le jugement de l’affaire et il est regrettable que la Cour
de Strasbourg ne l’ait pas souligné.
Or, cette possibilité donnée par
le Code de justice administrative n’est pas entièrement liée à la présence du
commissaire du gouvernement lors du délibéré.
Ce rôle spécifique qui n’existe
que devant le Conseil d’Etat est une réalité et non une apparence : la Cour
aurait été bien avisée d’en faire mention.
Conclusion
La leçon donnée par l’arrêt
Kress est donc incertaine, le satisfecit sous réserve relève sans
doute de l’adresse politique ou diplomatique, mais elle ne satisfait guère le
juriste.
Faut-il rappeler à cet égard
avec J. Kahn que ce qui fait le juge ce n’est pas la nature de la
question qui lui est posée mais la structure de la réponse qu’il donne (AJDA,
1974, p. 38)
Il est temps que la Cour de
Strasbourg délaisse les attraits surannés des appâts rances de l’apparence pour
une appréciation du fonctionnement réel des juridictions au regard des exigences
de la Convention.
Si l’arrêt Kress devait
contribuer à cette prise de conscience, il n’aurait pas été tout à fait inutile.
|
|
Débats
M. Frédéric Rolin
(Professeur à l’Université d’Evry-Val d’Essonne)
Je voudrais faire deux
observations à la suite de l'intervention très intéressante de M. Bertrand.
Au sujet de la responsabilité de
l'Etat pour dysfonctionnements de la justice, je voudrais indiquer qu’en
réalité, mais cela vous a peut-être échappé, il y a eu un arrêt important rendu
par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 23 février 2001 précisément
dans l'affaire de la Vologne, de l'affaire tragique du jeune Grégory. Dans cette
affaire, il est vrai que ce n'était pas directement la durée de la procédure qui
était en cause, mais c'était un arrêt, je crois important, parce qu’il marque
une évolution très substantielle de la notion de faute lourde engageant la
responsabilité de l'Etat. C’est-à-dire que nous avons admis par opposition à la
jurisprudence antérieure que des dysfonctionnements graves dans le service de la
justice, même si isolément ils étaient suffisants à constituer la faute lourde,
peuvent constituer cette faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat à
partir du moment où ils sont nombreux et ils marquent un manquement au devoir
élémentaire de bon fonctionnement de la justice. Il y a donc quand même là une
ouverture sur la responsabilité de l'Etat.
Quant à la deuxième
observation : vous avez dit que les textes concernant les avocats généraux à la
Cour de cassation devaient être modifiés, j'en suis tout à fait d'accord, là je
suis pleinement d'accord avec ce que vous avez dit, c’est en cours d'ailleurs.
Nous étudions actuellement tous les textes qui doivent être modifiés pour
supprimer l'apparence précisément de subordination des avocats généraux au
procureur général, l’apparence de subordination même au Garde des sceaux. Je
dois vous dire même qu'il y a actuellement un travail très important qui est
opéré par M. Badinter qui s'intéresse à cette question et qui est en train de
préparer des textes pour essayer de proposer cela à la Cour européenne des
droits de l'Homme. C’est simplement une observation complémentaire.
M. Victor Haïm
(Professeur associé à l’Université de Paris XI)
Je suis
l'auteur de la thèse selon laquelle la Cour doit être “ supprimée ” ou, du
moins, dans l’intérêt même des justiciables, ne plus pouvoir être invocable en
matière administrative, lorsqu’une personne publique est partie au litige
autrement que comme auteur d’une sanction.
Ce que je
viens d’entendre à l’instant sur le fonctionnement supposé des tribunaux
administratifs – qui relève de la réécriture du C.J.A. plus que de sa lecture -
me conforte dans le sentiment que le droit à un procès équitable est à ce prix.
En effet, si des juristes français ne peuvent voir la place du Commissaire du
gouvernement dans le processus de décision juridictionnelle et l’intérêt de
cette institution pour les justiciables, comment attendre que des juristes
auxquels notre système est totalement étranger le comprennent ?
Je voudrais
faire sur ce point trois observations.
1) La première concerne les
formations de jugement et le rattachement des Commissaires du gouvernement.
Le Code
définit la structure des juridictions administratives et le nombre de leurs
chambres ; toujours en vertu du Code, il appartient aux présidents de
juridiction d’affecter les magistrats dans ces chambres qui, par ailleurs,
constituent aussi – toujours en vertu du Code – les formations normales de
jugement. Ainsi, comme l’a d’ailleurs relevé le professeur Bertrand, il n’y a
pas de spécificité statutaire des Commissaires du gouvernement comme il y en a
une des membres du parquet : les Commissaires du gouvernement sont, à l’instar
des présidents de chambre et des rapporteurs, membres de la chambre/formation de
jugement à laquelle ils ont été affectés et ils ont le même cursus professionnel
que leurs collègues affectés dans les fonctions de rapporteur. D’ailleurs, ceux
qui sont en poste dans les tribunaux administratifs peuvent être à la fois
Commissaire du gouvernement et rapporteur (dès lors, du moins, que ce n’est pas
sur les mêmes dossiers !). En revanche, conformément à une tradition qui pourra
paraître contestable, ils se trouvent momentanément écartés de la formation de
jugement lorsqu’il s’agit de décider (vote) au moment du délibéré.
2) Ma deuxième observation sera
une sorte de plaidoyer pro domo. En écoutant le précédent intervenant
j’ai eu l’impression que, selon lui, il n’y a que deux personnes qui voient les
dossiers - le rapporteur et le Commissaire du gouvernement - et que le
Commissaire du gouvernement, qui est le dernier à parler, va marquer la
formation de jugement et se révéler un “ adversaire objectif ” de la partie
contre laquelle il aura conclu.
Cette
approche est révélatrice d’une incontestable méconnaissance des juridictions
administratives et est finalement très choquante parce qu’elle suppose ou
implique comme conception de leur fonctionnement.
En premier
lieu, contrairement à ce qui a été dit, il n’y a pas que deux personnes qui
voient les dossiers, mais trois : le rapporteur, le président de la formation et
le Commissaire du gouvernement.
En second
lieu, sauf si le rapporteur et le président ont de la réponse à apporter à une
question une analyse différente, le Commissaire du gouvernement, s’il ne partage
pas l’analyse de ses collègues, devra les convaincre, ainsi que le troisième
membre de la formation, du bien-fondé de son analyse. Le nombre joue toujours
contre lui.
En troisième
lieu, selon mon expérience les membres d’une formation de jugement sont
suffisamment avertis et intelligents pour, selon le cas, reprendre la thèse du
Commissaire du gouvernement ou l’écarter. Et parce que je pense qu’une formation
de jugement n’est pas nécessairement composée uniquement d’imbéciles et de
simples d’esprit et que ce n’est donc pas forcément le dernier à avoir parlé qui
a raison, il me paraît déplacé d’accorder au Commissaire du gouvernement un
poids ou une autorité qu’il est loin d’avoir toujours.
3) Ma troisième observation me
fera quitter un court instant le plan juridique.
Il est sans
doute inutile de rappeler qu’il est impossible de soutenir son attention pendant
bien longtemps et plus encore de mémoriser tous les détails d’un exposé ou d’une
démonstration. Il y a un temps d’écoute et un temps d’assimilation. Si on
interrogeait, au hasard, une personne dans l’auditoire en lui demandant de
répéter le début de l’exposé que vient de faire le professeur Bertrand, nul
doute qu’elle n’y arriverait pas. Lorsque le Commissaire du gouvernement a
rappelé des faits et exposé des questions de droit pendant 3 heures, qui oserait
soutenir qu’au moment du délibéré il ne serait pas utile qu’il rappelle tel ou
tel point du dossier ou de la jurisprudence sur laquelle il s’est appuyé ? Et
s’il doit parler à l’audience pour définitivement se taire après nonobstant
cette déperdition d’information dont il aurait pu avoir pour mission de limiter
les effets, quel peut être l’intérêt de maintenir l’institution ? Autant la
supprimer ou, mieux encore, laisser le Commissaire du gouvernement décider sur
quels dossiers il conclura à l’audience.
En
définitive, par delà la référence aux notions d’ “ alliés ” et d’ “ adversaires
objectifs ” - qui ont plus leur place dans l’idéologie althussérienne ou sous la
plume d’un pronostiqueur hippique que dans l’analyse de la mission et du travail
de réflexion du juge (quelles que soient ses fonctions dans sa chambre) -, le
fait que le Commissaire du gouvernement soit présent et qu’il puisse s’exprimer
s’il y est invité par le président de la formation, me semble non seulement
utile, mais même nécessaire et dans l’intérêt du justiciable, si, du moins, on a
à l’esprit que le Commissaire du gouvernement a, comme les autres membres de la
formation, le souci de trouver la solution juridiquement la meilleure possible
au litige sur lequel il faut statuer.
Je ferai une
dernière remarque.
Globalement,
les juridictions administratives – C.E., C.A.A. et T.A. – rendent environ 100 à
150.000 décisions par an (en moyenne 1 an après l’introduction de la demande
dans les tribunaux administratifs et 2 ans dans les Cours). Or, en 2001, sauf
erreur de ma part, il n’y a eu guère plus d’une douzaine d’arrêts de la Cour
européenne des droits de l’Homme rendus dans des litiges mettant en cause la
méconnaissance de l’art. 6 § 1 de la Convention par ces juridictions. J’en
déduis que le fonctionnement actuel de la juridiction administrative ne paraît
pas, à l’immense majorité des justiciables, à ce point attentatoire au droit à
un procès équitable qu’ils se précipitent tous à Strasbourg – où, soulignons le,
leur affaire, aussi simple soit-elle, ne sera pas jugée avant 3 ou 4 ans, par
une Cour plus soucieuse de l’apparence du Droit que de sa réalité et des droits
des justiciables, et qui accordera finalement au requérant le “ tarif syndical ”
de 30 ou 40 000F (5 à 6 000 €) en réparation d’un préjudice moral dont
l’évidence n’est pas toujours la première vertu. Il n’y a pas là de quoi
bouleverser l’équilibre budgétaire d’un pays, ni même, plus modestement, de quoi
inciter à d’importantes réformes de la justice dont on voit déjà qu’elles auront
pour objet d’accélérer le jugement des affaires au détriment de la justice et
des droits des justiciables.
Mais je
pense que j’aurai peut-être quelques contradicteurs et je laisse la parole.
M. Jocelyn
Clerckx (Docteur
en droit)
Je souhaiterais poser une
question au professeur Bertrand. L’arrêt Kress pose le principe de
l’interdiction de la participation du Commissaire du gouvernement au délibéré,
ce dernier ayant déjà été amené à se prononcer ouvertement sur l’affaire en
cause. Pourtant, et vous avez insisté sur ce point, le Commissaire du
gouvernement est bien un juge. On est tenté dès lors de faire un rapprochement
avec le rapporteur, qui lui aussi, juge à part entière, participe au délibéré,
alors que de par ses fonctions il a également été conduit, un peu comme le
Commissaire du gouvernement, à prendre préalablement position. Si l’on se place
dans la logique de l’arrêt Kress, cette situation ne risque-t-elle pas,
elle aussi, d’être incompatible, aux yeux des juges de Strasbourg, avec le
principe d’impartialité ?
M. François-Guilhem
Bertrand
L’interdiction de la
participation du juge rapporteur au délibéré serait effectivement dans la
logique de l’arrêt Reinhardt (CEDH 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane
Kaïd, Cahiers du CREDHO, n° 5, p 41).
Cependant, comme j’ai essayé de le montrer, il y a une double
évolution dans la jurisprudence de la Cour. La première va de l’arrêt
Borghers
(30 octobre 1991) à l’arrêt
Rheinhardt
de 1998 qui marque en quelque sorte le sommet de la critique par
la Cour du système procédural français. Mais, ensuite, de l’arrêt Reinhardt à
l’arrêt
Kress,
on peut noter une évolution en sens inverse. La Cour admet aujourd’hui que le
rapporteur n’est pas l’allié objectif de l’une des parties.
Cette
position ancienne de la Cour témoignait d’une méconnaissance totale de ce qu’est
le rôle du rapporteur et de la manière dont les choses se passent concrètement.
Contrairement à une idée reçue, le rapporteur ne vient pas à l’audience avec un
seul projet d’arrêt qu’il va s’efforcer de faire adopter. Dans les affaires
délicates, le rapporteur propose plusieurs projets d’arrêts, il est l’allié
objectif de la majorité qui va se dégager au sein de la juridiction mais
sûrement pas d’une des parties.
J’en viens
au rôle du Commissaire du gouvernement.
Je crois
qu’il faut bien distinguer son rôle direct dans l’affaire en cause et son rôle
indirect dans les affaires ultérieures.
Un exemple
fera mieux comprendre que ce rôle indirect ne découle pas de sa présence au
délibéré mais de la réflexion qu’il engage à propos d’une affaire ultérieure
avec éventuellement un autre commissaire du gouvernement et une autre
composition. Le Tribunal des conflits a jugé en 1982 que l’activité des
abattoirs publics était, depuis la loi de 1965, une activité industrielle et
commerciale relevant des tribunaux de l’ordre judiciaire (TC 8 novembre 1982,
Société anonyme
Maine-Viande et autres,
Rec.,
p. 460).
Cette
décision, rendue sur renvoi du Conseil d’Etat, pour difficulté sérieuse de
compétence, ne s’explique que si l’on se réfère à un épisode antérieur. Quelques
mois auparavant, M. Braibant, commissaire du gouvernement, concluait devant le
Conseil d’Etat dans une affaire de redevance d’abattage d’un abattoir public.
Ces affaires
venaient régulièrement devant le Conseil d’Etat et aucune difficulté de
compétence n’était soulevée ; on considérait que l’activité des abattoirs
publics était une activité de service public administratif relevant des
tribunaux administratifs. Or, ce jour là, M. Braibant a évoqué le problème de
compétence par une remarque incidente qui ne figurait même pas dans ses
conclusions écrites. La remarque est donc passée inaperçue… sauf du jeune avocat
qui était présent ce jour là.
La réflexion de M. Braibant
s’est poursuivie et a abouti à la décision Maine-Viande, mais ce que je
veux souligner avec force c’est que le raisonnement du Commissaire du
gouvernement n’a pas pesé sur la première décision mais dans une autre affaire
rendue postérieurement par une autre juridiction.
Donc, contrairement à la crainte
implicitement contenue dans la décision Kress, l’influence du Commissaire
du gouvernement n’est pas liée à sa présence au délibéré mais à des facteurs qui
sont parfois extérieurs à sa prestation et qui vont jouer un rôle dans
l’évolution de la jurisprudence.
M. Frédéric
Rolin
Un dernier mot pour ce qui
concerne l'opinion de M. Haïm qui estime que le commissaire du gouvernement fait
partie de la formation du jugement. J'aimerais qu’on me cite la ou les
dispositions du code de justice administrative sur la composition des formations
de jugement, et qu’on me montre laquelle mentionne le commissaire du
gouvernement comme en faisant partie. Et si elle n'existe pas, j'aimerais qu’on
m’explique comment un jugement peut être rendu dans une formation autre que
celle qui est prévue par la loi.
M. Paul
Tavernier
Je n’interviendrai pas dans ce
débat sur l’affaire Kress et je crois qu’on pourrait en parler très
longtemps, mais les trois exposés que nous avons entendus peuvent susciter
quelques remarques d’ordre général. Malgré l’apparente disparité et diversité
des questions abordées, tout tourne autour de l’équité de la procédure et je
dirai d’abord qu’il y a une remarque qui m’a beaucoup intéressée. Mme d’Urso,
-ou le ministère de la Justice-, a été surprise du fait que la Cour de
Strasbourg n’a pas bien compris le système français de la curatelle. Au
contraire dans l’affaire Kress, François-Guilhem Bertrand nous a montré
que l'arrêt présente quelques éléments positifs, dûs probablement à la présence
de Jean-Paul Costa. Il est vrai que la présence du juge national est très
importante, mais la plaidoirie et le fait pour le gouvernement d’expliquer sa
position et les particularités de son système juridique peut aussi éclairer la
Cour sur les subtilités du droit national. C’est un premier point. D’autre part,
il me semble que les trois affaires montrent l’importance de la clarté de la
législation nationale parce que toutes les difficultés qu’on a soulevées à
propos de l’équité de la procédure tenaient à des dispositions compliquées, sans
doute trop compliquées, notamment en matière de délais. Effectivement le système
qui fait courir le délai du départ de la lettre n’est peut-être pas très
satisfaisant. Même si c’est un point de détail, pourrait-on dire, cela entraîne
des conséquences importantes pour le justiciable. L’Etat a donc une obligation
de clarté rappelée dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.
Une dernière remarque : il ne
faut pas trop se concentrer sur les affaires françaises ou francophones. Les
Britanniques sont de plus en plus mis en cause devant la Cour de Strasbourg, me
semble t-il, pour des problèmes d’équité de la procédure. Il y a eu toute une
série d’arrêts rendus cette année. Le Royaume-Uni, qui a pourtant une longue
tradition dans ce domaine, doit aussi revoir sa copie sur un certain nombre de
points.
Mme Françoise
Tulkens
Je trouve tout d’abord que les
différents commentaires et analyses des arrêts de la Cour sont d’un très grand
intérêt. En outre, la lecture des arrêts de la Cour par une bonne doctrine, une
doctrine imaginative, créatrice, qui permet d’aller plus loin, nous aide
beaucoup dans notre travail. Elle permet la clarification de certains points, la
mise en évidence de certaines ambiguïtés ou de certaines faiblesses. J’y suis en
ce qui me concerne très attentive car j’y vois autant d’occasions d’affiner le
raisonnement, d’améliorer mon travail.
En ce qui concerne l’affaire
G.B. c/France (arrêt du 2 octobre 2001), il faut rappeler qu’il y avait un
précédent dans cette affaire, l’arrêt Bernard c/France du 23 avril 1998.
Or, vous savez que la Cour est attentive à la question des précédents. Elle l’a
dit expressément dans l’arrêt Cossey c/Royaume-Uni du 27 septembre 1990
(§ 35) et l’a rappelé dans l’arrêt Chapman c/Royaume-Uni du 18 janvier
2001 : “ Sans être formellement tenue de suivre l’un quelconque de ses arrêts
antérieurs, la Cour considère qu’il est dans l’intérêt de la sécurité juridique,
de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi qu’elle ne s’écarte pas sans
motif valable des précédents. La Convention étant avant tout un mécanisme de
défense des droits de l’Homme, la Cour doit cependant tenir compte de
l’évolution de la situation dans les États contractants et réagir, par exemple,
au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre ” (§ 70).
Dans l’analyse de l’arrêt
Krombach c/France du 13 février 2001, j’éprouve une certaine difficulté à
suivre le commentateur lorsqu’il soutient que la jurisprudence de la Cour
conduirait à reconnaître le droit pour le prévenu de ne pas assister à son
procès. Ceci me paraît une généralisation qui va au-delà de la lettre et de
l’esprit de la jurisprudence de la Cour en cette matière. Dans cet arrêt, comme
dans des arrêts antérieurs tels par exemple l’arrêt Van Geyseghem c/Belgique
du 21 janvier 1999, la Cour a, dans la confrontation entre les droits, soutenu
que l’accusé ou le prévenu ne pouvait perdre le bénéfice des droits de la
défense en raison de son absence au procès. La Cour s’est située dans le cadre
de cet équilibre là.
Dans la mesure où tout ce qui
concerne la procédure devant la Cour de cassation en France soulève de
nombreuses interrogations, je pense qu’il serait intéressant de les regrouper
dans une analyse d’ensemble. Il y a un point que je voudrais encore ajouter et
qui concerne le recours à un avocat spécialisé. D’un côté, j’entends de tous
côtés et je peux comprendre l’argument, qu’il est illusoire pour une personne
individuelle, sans avocat ou alors avec un avocat “ ordinaire ”, de défendre
valablement ses chances devant l’instance en cassation. Le fait qu’en France,
comme dans d’autres pays, un avocat spécialisé en matière pénale ou dans le
contentieux social n’est pas requis, n’est-ce pas créer une forme d’illusion ?
D’un autre côté, toute la question de l’aide juridictionnelle devant la Cour de
cassation me pose aussi, quant à moi, problème. J’ai des difficultés à accepter
la doctrine de l’absence de moyen de cassation sérieux à appliquer uniquement au
justiciable qui sollicite l’aide juridictionnelle. Mais cela, comme je l’ai dit
dans une opinion dissidente dans l’arrêt Del Sol c/France du 26 février
2002, c’est une opinion personnelle et, contrairement au beau film que je viens
de voir, “ Une hirondelle a fait le printemps ”, l’opinion d’un juge n’est pas
celle de la Cour !
Ma dernière question concerne
les délais de procédure. De tous côtés est invoqué le fait que des procédures
trop longues entraînent en définitive un déni de justice. Je le constate bien
fréquemment. Comment effectivement réagir à ce mal qui gangrène de nombreux
systèmes judiciaires des pays européens ? La loi Pinto qui a été adoptée en
Italie introduit un recours, de nature indemnitaire, devant les tribunaux
internes. Cette voie de recours est donc, dans l’état actuel des choses, à
épuiser avant de s’adresser à la Cour. Il faudra toutefois que la Cour examine
le caractère effectif de ces recours. En France, l’article 781-1 du Code de
l’organisation judiciaire est également désormais considéré, dans la
jurisprudence de la Cour, comme une voie de recours à épuiser avant d’introduire
une requête devant la Cour. Il s’agit également d’un recours indemnitaire. La
question qui est actuellement posée, par rapport à cette disposition, est celle
de savoir si cette voie de recours interne s’applique uniquement aux affaires
qui sont terminées dans l’ordre interne ou également à celles qui y sont
pendantes ? Une requête devant la Grande chambre, Mifsud c/France,
sera appelée à trancher la question. Certes, dans les deux pays, l’existence de
voies de recours internes, de nature indemnitaire, n’est pas susceptible
d’accélérer la procédure et oblige les justiciables à mener de front leur
procédure principale et leur procédure en indemnisation.
|