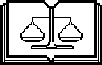|
La
Cour de cassation et le procès équitable
Le
contrôle de l'irrecevabilité des moyens nouveaux
devant
la Cour de cassation :
l'affaire
Dulaurans (21 mars 2000)
par
Vincent
Delaporte
Avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
1.
L'affaire Dulaurans n'est pas la
première dans laquelle la CEDH s'en prend à la Cour de cassation française,
mais c'est probablement celle qui a été le plus mal accueillie par notre Haute
Juridiction qui a estimé franchies les bornes du tolérable.
Essayons
d'analyser l'affaire objectivement. Je voudrais dire aussi avec clarté et précision.
Ce ne sera pas facile car dans cette affaire tout est approximatif :
l'argumentation à géométrie variable de la requérante aux différents stades
de la procédure, la réponse donnée par les juges du fond puis par la Cour de
cassation, et enfin l'arrêt de la Cour européenne. On a l'impression
d'assister à un jeu de miroirs déformants, à un dialogue de sourds entre la
requérante, les juridictions françaises et la Cour européenne, nul ne
comprenant ce que soutenaient exactement les autres.
A
l'origine, Mme Dulaurans a souhaité mettre en vente deux appartements qui lui
appartenaient. Elle s'est adressée pour cela à un marchand de biens, M. Ben
Naceur. Rappelons, pour les étudiants ici présents, que le marchand de biens
achète et revend des immeubles en son propre nom et pour son propre compte et
tire son bénéfice de la différence entre le prix d'achat et le prix de
revente, alors que l'agent immobilier est un intermédiaire qui met en relation
vendeurs et acheteurs et dont la rémunération consiste dans des honoraires
appelés "commission" à la
charge de la partie qui l'a mandaté. Par conséquent, quand M. Ben Naceur qui
affiche la profession de marchand de biens, reçoit le pouvoir de vendre deux
immeubles, il n'agit pas en tant que marchand de biens mais en tant qu'intermédiaire,
chargé de trouver une personne intéressée par l'achat des immeubles de Mme
Dulaurans, pour le prix demandé par celle-ci, qui était en l'espèce de 20
millions pour l'ensemble des deux immeubles. M. Ben Naceur trouva un acquéreur
et Mme Dulaurans substitua à la procuration du 15 novembre 1991, qui semblait
être globale pour les deux immeubles, deux nouvelles procurations en date du 25
novembre 1991 et qui portaient le prix à 20 millions de francs pour le premier
immeuble et à 2 millions de francs pour le second immeuble. Fort de ces
nouvelles procurations, M. Ben Naceur poursuivit les négociations avec l'acquéreur
et un accord ferme semble être intervenu le 27 novembre 1991.
L'affaire
n'en resta pas là car Mme Dulaurans avait de son côté cherché elle aussi un
acquéreur et elle en avait trouvé un lui proposant un prix supérieur à celui
qui était indiqué dans la procuration du 25 novembre.
Elle
adressa donc une lettre recommandée à M. Ben Naceur pour lui notifier la révocation
des mandats du 25 novembre.
A
quoi M. Ben Naceur répondit qu'il avait déjà consenti deux promesses de vente
qui engageaient bien évidemment sa mandante.
Il
faut croire que l'offre présentée par l'acquéreur trouvé directement par Mme
Dulaurans était bien alléchante car celle-ci a voulu se dégager des
engagements pris en son nom par M. Ben Naceur. Pour faire renoncer les acquéreurs
bénéficiaires des promesses de vente consenties par M. Ben Naceur, elle leur
versa des indemnités de dédit : 900.000 francs à l'un et 350.000 francs à
l'autre.
Il
restait cependant à désintéresser M. Ben Naceur qui avait accompli son mandat
: Mme Dulaurans passa donc avec lui une transaction dans laquelle elle
s'engageait à lui verser une indemnité forfaitaire de 500.000 francs.
Indemnité
qu'elle a refusé de payer et c'est ce qui a valu à la Cour de cassation d'être
montrée du doigt par la Cour européenne.
2.
Bien entendu, M. Ben Naceur a saisi les tribunaux pour contraindre Mme
Dulaurans à payer cette indemnité transactionnelle de 500.000 francs. Pour
s'opposer à ce paiement, Mme Dulaurans a fait valoir que le mandat donné à M.
Ben Naceur était frappé de nullité en raison du non respect par ce dernier
des conditions d'exercice de l'activité d'agent immobilier, résultant de la
loi du 2 janvier 1970. Bien que les arrêts ne donnent pas de précision à ce
sujet, on peut présumer que l'irrégularité de la situation de M. Ben
Naceur tenait au défaut de délivrance de la carte professionnelle normalement
délivrée par le préfet et dont doit justifier toute personne prêtant son
concours "de manière
habituelle" aux opérations portant sur les biens d'autrui (art. 1er
et 3 de la loi). Selon la jurisprudence, deux mandats suffisent à caractériser
la condition d'habitude exigée par la loi. Ainsi Mme Dulaurans soutenait qu'à
défaut de carte professionnelle, M. Ben Naceur n'exerçait pas régulièrement
la profession d'agent immobilier et ne pouvait avoir droit à aucune rémunération.
Les procurations données étaient donc nulles et la transaction intervenue sur
ces procurations nulles était elle-même nulle.
Mme
Dulaurans invoquait également la nullité de la transaction pour dol et
violence morale. Mais je laisse de côté cet aspect du litige qui n'a aucune
incidence dans notre affaire, puisque ce moyen a été abandonné devant la Cour
de cassation.
A
ce stade de l'affaire, on voit déjà que la bonne foi et le respect de la
parole donnée ne semblent pas du côté de Mme Dulaurans, qui n'a pas contesté
la réalité du mandat de vente, puisqu'elle a réglé sans contestation un dédit
aux deux acquéreurs trouvés par son mandataire. Et le moyen développé sur
l'habitude à l'égard de M. Ben Naceur relève davantage de la chicane que du
bon sens. Mme Dulaurans avait en effet d'abord donné à M. Ben Naceur le 15
octobre 1991 un seul mandat portant sur deux immeubles. Ce mandat unique ne
caractérisait pas l'habitude ; mais il avait été remplacé par deux mandats,
un pour chaque immeuble, le 25 novembre 1991. Et Mme Dulaurans prétendait déduire
de cette division de pure forme la pluralité des mandats et par voie de conséquence
l'habitude qui aurait rendu nul son engagement de payer 500.000 francs.
Sans
doute agacé d'avoir à répondre à une telle argutie, le Tribunal de grande
instance de Nanterre condamna Mme Dulaurans à payer à M. Ben Naceur la somme
de 500.000 francs. Si l'on en croit l'arrêt de la Cour européenne, le tribunal
n'a pas répondu au moyen tiré par la requérante de la nullité de la
transaction sur le fondement de la loi du 2 janvier 1970.
3.
Pour ma part, je pense que la contestation de Mme Dulaurans était un pur
artifice. D'abord parce qu'elle avait à l'origine donné un seul mandat, dont
la division ultérieure en deux mandats différents pour chacun des immeubles ne
caractérisait pas une habitude, d'autre part et surtout parce que M. Ben Naceur
ne réclamait pas la rémunération prévue dans ses mandats mais celle qui
avait été prévue par une transaction qui, au terme de l'article 2052 du Code
civil, avait autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties.
Et c'était en vain que Mme Dulaurans prétendait que cette transaction était
nulle pour avoir été passée en exécution d'un titre nul (art. 2054), car la
prétendue ignorance de la nullité du titre ne pouvait résulter que d'une
erreur de droit. Mme Dulaurans avait connaissance de tous les éléments de fait
qui auraient pu justifier selon elle la nullité des mandats. Par conséquent,
si, en connaissance de ces éléments de fait, elle ignorait la nullité des
mandats, ce ne pouvait être que par une erreur de droit qui lui interdisait de
demander la nullité de la transaction.
Mais
ce n'est pas cela qui a été répondu à Mme Dulaurans.
4.
Celle-ci a donc interjeté appel. Et devant la Cour, elle a affiné son
argumentation en faisant allusion non plus aux seuls mandats des 15 octobre et
25 novembre 1991, mais également à d'autres interventions faites par M.
Ben Naceur pour l'acquisition de divers biens immobiliers pour un montant total
de 5 millions de francs (opération concrétisée par un acte du 14 octobre
1991).
Par
conséquent, M. Ben Naceur serait également intervenu antérieurement, on ne
sait trop sous quelque forme, dans le cadre d'une opération concrétisée par
un acte du 14 octobre 1991. Ce dernier acte est-il l'acte de vente (entre
vendeur et acquéreur) ou le mandat donné à M. Ben Naceur ? On n'en sait rien.
Et même si l'on s'en tient à l'arrêt de la Cour, on ignore tout de la nature
de l'intervention à laquelle font allusion les conclusions d'appel de Mme
Dulaurans.
C'est
en cet état que la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement attaqué
en affirmant de façon sans doute un peu lapidaire "qu'en sa qualité de
marchand de biens ne se livrant pas d'une manière habituelle aux opérations
visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, M. Ben Naceur
ne tombe pas sous le coup de cette loi".
5.
Mme Dulaurans s'est pourvue en cassation. Elle reprochait à la cour d'appel
d'avoir rejeté sa demande en nullité de la transaction par le motif que M. Ben
Naceur en sa qualité de marchand de biens ne se livrait pas d'une manière
habituelle aux opérations visées par la loi du 2 janvier 1970, " alors
que ... les obligations (édictées par la loi du 2 janvier 1970) étant
sanctionnées pénalement, l'élément d'habitude est constitué dès la première
réitération de leur transgression ; qu'ainsi il importait peu que M. Ben
Naceur eût exercé, fût-ce à titre principal, une autre activité de marchand
de biens dès lors que la constatation de la pluralité de mandats relatifs à
des opérations bien distinctes caractérisait l'accomplissement d'une manière
habituelle d'opérations portant sur les biens d'autrui (violation des articles
2054 du Code civil et 1er et 7 de la loi du 2 janvier 1970)".
Rejet
du pourvoi par le motif suivant :
"
Mme Dulaurans qui initialement le 15 octobre 1991, avait consenti un pouvoir
pour vendre les deux immeubles en stipulant un prix minimum de l'ensemble n'a
pas soutenu dans ses conclusions que M. Ben Naceur, d'une manière habituelle,
se livrait ou prêtait son concours aux opérations prévues par la loi du 2
janvier 1970 ; qu'elle n'est pas recevable à le faire pour la première fois
devant la Cour de cassation".
6.
Mme Dulaurans n'en est pas restée là et a donc saisi la Cour européenne
qui, par un arrêt du 21 mars 2000, a censuré la France, et donc la Cour de
cassation, par une motivation bien peu convaincante :
"La
requérante n'a pas cessé, dès le début de la procédure litigieuse, de prétendre
que son adversaire était soumis aux dispositions de la loi de 1970. Tant en
première instance qu'en cassation, elle a clairement affirmé que le caractère
habituel de la mission confiée à son adversaire résultait des deux mandats
qui lui avaient été donnés le 25 novembre 1991 en vue de vendre deux
immeubles. S'il est vrai que devant la cour d'appel, la requérante souligna que
son adversaire était déjà intervenu auprès d'elle à l'occasion d'une précédente
vente, sans se référer expressément aux deux mandats litigieux, la Cour
estime néanmoins qu'on ne saurait parler en l'espèce de deux raisonnements
distincts. En indiquant que son adversaire était déjà intervenu auprès
d'elle, la requérante ne pouvait que faire allusion (sic)
aux deux mandats à l'épicentre du litige, auxquels elle s'était déjà référée
devant le tribunal de première instance et auxquels elle se référa par la
suite devant la Cour de cassation ... » (arrêt, § 36).
Il
reste à apprécier cette solution.
7.
Préalablement, je voudrais mettre l'arrêt de la Cour à l'abri d'une des
principales critiques qui lui ont été adressées, et sans doute la plus
fondamentale, celle de s'être arrogée un pouvoir de contrôle sur le caractère
de nouveauté d'un moyen retenu par la Cour de cassation. Selon certains, la
Cour aurait commis là un véritable excès de pouvoir, car son rôle se
limiterait à sanctionner la violation directe de la convention, mais non la
violation indirecte qui résulterait d'une simple mauvaise appréciation des
faits de la cause. Cette critique part de l'idée qu'il y aurait un partage des
compétences ou du moins des pouvoirs entre les autorités nationales et la Cour
européenne : lorsque la violation alléguée des droits définis par la
convention consisterait dans une mauvaise application des règles du droit
national, les autorités nationales seraient souveraines pour apprécier les éléments
de fait dont dépendent ces règles nationales. Autrement dit, il y aurait,
entre les autorités nationales, donc la Cour de cassation, et la Cour européenne
un partage analogue à celui qui existe entre la Cour de cassation et les juges
du fond. Ces derniers apprécient souverainement les éléments de fait et la
Cour de cassation se borne à vérifier s'ils ont tiré les conséquences
juridiques appropriées des éléments de fait qu'ils ont constatés. Ce serait
la même chose entre la Cour de cassation et la Cour européenne. La Cour européenne
aurait le pouvoir de dire abstraitement si l'irrecevabilité d'un moyen nouveau
devant la Cour de cassation est contraire ou conforme aux exigences de l'article
6 § 1 de la convention ; et on sait qu'elle a reconnu la conformité de cette règle
(CEDH, 29 août 2000, req. 40-490/98, Jahnke et Lenoble, JCP. 2000 II n° 10435,
note Perdriau). Mais ce point étant acquis, la Cour de cassation serait
souveraine pour décider si un moyen est ou non nouveau.
Cette
thèse ne paraît pas admissible car, selon une formule constante de la Cour, la
convention ne garantit pas des droits abstraits et théoriques, mais des droits
effectifs et concrets. La Cour, à peine de rendre son contrôle de pure forme,
ne peut donc s'en tenir à un contrôle abstrait et théorique des violations
directes de la convention. Elle doit rechercher et elle recherche effectivement
si, même en l'absence d'une violation ouverte de la convention, les autorités
nationales n'ont pas dissimulé une violation indirecte et larvée sous une appréciation
erronée des faits.
On
ne peut donc pas reprocher à la Cour européenne, dans son arrêt du 21 mars
2000, de ne pas s'être arrêtée à l'affirmation de la Cour de cassation selon
laquelle le moyen était nouveau et d'avoir recherché elle-même si tel était
le cas.
On
doit du reste signaler, à juste titre, que dans une précédente affaire qui
n'avait pas suscité tant d'émoi, la Commission avait constaté la violation de
l'article 6 § 1 par un arrêt de la Cour de cassation qui avait déclaré
irrecevable un moyen comme contraire à l'argumentation soutenue devant les
juges du fond, alors que c'était la même thèse qui avait été soutenue tant
en appel que devant la Cour de cassation (aff. Fouquet, rapport de la
commission, 12 oct. 1994, req. n° 20.398/92).
Cela
étant, la Cour doit exercer ce contrôle avec prudence et modération, car un
contrôle trop poussé conduirait à deux conséquences inadmissibles :
-
D'une part, si la Cour voyait une violation de l'article 6 chaque fois qu'une règle
de droit national a été mal appliquée à ses yeux, autant dire que le droit
substantiel serait incorporé dans le droit au procès équitable. Le droit au
procès équitable impliquerait non seulement le respect formel de la procédure,
mais encore le respect des règles substantielles. L'article 6 § 1 absorberait
non seulement la procédure, mais également la totalité du droit substantiel.
-
Cette extension du domaine de l'article 6 entraînerait par voie de conséquence
une extension du champ d'intervention de la Cour qui, par le biais du contrôle
de l'article 6, serait transformée en cours de révision de l'ensemble des
juridictions nationales.
Il
est évidemment impossible d'aller jusque là et c'est pourquoi l'équilibre me
paraît être dans la notion d'erreur manifeste d'appréciation. Pour que le
procès soit équitable et non pas une simple parodie, le juge doit appliquer
les règles de droit, et les juridictions nationales disposent d'une grande
marge de manœuvre dans l'interprétation et l'application de leur droit
national, sous la seule réserve d'erreur manifeste qui rendrait l'accès au
juge illusoire.
Tels
étant les principes, il me semble que dans la présente affaire Dulaurans, c'est la Cour européenne et non la Cour de cassation qui
a commis une erreur manifeste.
La
Cour en effet ignore purement et simplement une règle évidente et parfaitement
connue de tous les praticiens, à tel point que nul ne peut être choqué de ce
que la Cour de cassation ne la rappelle pas à l'occasion de chaque affaire ; en
outre, elle oublie de définir la notion qui était à la base même de sa décision,
c'est-à-dire la notion de moyen.
8.
La règle connue de tous les praticiens est énoncée expressément à
l'article 954 du nouveau Code de procédure civile :
"
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions de la partie et
les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ... la partie
qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens
qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses
conclusions de première instance ...".
Personne
ne pourrait se déclarer choqué d'une telle règle qui n'est que l'expression
du bon sens : c'est aux parties qu'il incombe d'indiquer aux juges ce qu'elles
demandent et pourquoi elles le demandent, et l'interdiction de se référer aux
écritures de première instance est strictement conforme à l'analyse de
l'appel comme voie d'achèvement : puisque l'appel permet d'achever le procès,
il est logique d'imposer à l'appelant de repenser et de reconstruire son
argumentation pour tenir compte des objections qui lui ont été faites par les
premiers juges.
Par
voie de conséquence, la nouveauté d'un moyen, devant la Cour de cassation,
s'apprécie exclusivement par référence aux conclusions d'appel. Puisque la
cour d'appel n'a pas à se référer aux conclusions de première instance qui
sont réputées abandonnées, la Cour de cassation ne peut pas elle non plus
apprécier la recevabilité du moyen par référence à ces conclusions.
Un
plaideur est assez mal venu de reprocher au juge de n'avoir pas répondu à des
conclusions dont il ne l'avait pas saisi.
La
Cour ne pouvait donc apprécier la nouveauté du moyen soutenu devant la Cour de
cassation en se référant aux conclusions de première instance.
9.
Ensuite, la Cour européenne aurait pu s'arrêter quelques instants à la définition
du moyen. Cette notion s'applique au raisonnement qui justifie la prétention
d'un plaideur. Un moyen comporte donc :
-
l'énoncé d'une règle de droit ;
-
l'énoncé des faits pertinents au regard de cette règle de droit ;
-
les conséquences que la règle de droit attache aux faits ainsi énoncés.
Ces
trois éléments doivent être présentés ensemble et dans un raisonnement
construit. Le degré de précision de chaque élément varie selon les
circonstances. Ainsi, lorsque la règle de droit consiste dans la force
obligatoire du contrat, il n'est pas besoin d'en faire un exposé abstrait ; il
suffit de rappeler le contrat et les conséquences que la partie y attache.
Quant aux éléments de fait pertinents, ils doivent être énoncés de manière
suffisamment précise et dans tous les cas ils doivent être assortis d'une
offre de preuve. L'allégation de faits vagues, imprécis, non prouvés, ne
permet pas au juge de procéder à la qualification au regard de la règle de
droit invoquée.
En
l'espèce, les conclusions de Mme Dulaurans devant la cour d'appel, telles du
moins qu'elles sont rappelées par l'arrêt de la Cour européenne, étaient
totalement inconsistantes. Sans doute, Mme Dulaurans avait-elle bien invoqué la
nullité des mandats en application de la loi du 2 juillet 1970, en raison de ce
que son adversaire se livrait à des opérations d'intermédiaire d'une manière
habituelle, et l'on peut regretter que la Cour de cassation ait déclaré le
contraire un peu brusquement.
Cela
étant, l'arrêt de la Cour de cassation peut se comprendre sans grand effort :
les conclusions d'appel de Mme Dulaurans invoquaient bien l'habitude, mais sans
préciser en quoi cette habitude était caractérisée.
La
Cour européenne reconnaît elle-même que "devant la cour d'appel, la requérante
soulignait que son adversaire était déjà intervenu auprès d'elle à
l'occasion d'une précédente vente, sans se référer expressément aux deux
mandats litigieux". Autrement dit, Mme Dulaurans invoquait l'habitude
mais ne visait qu'un seul mandat ; et encore, il faut être indulgent pour dire
qu'elle invoquait un mandat puisqu'elle se bornait à dire que M. Ben Naceur était
intervenu précédemment, sans même préciser la forme, les modalités et la
nature de cette intervention. On ne sait donc rien sur le rôle joué par M. Ben
Naceur dans une précédente transaction. Cela ne pouvait en aucune façon
caractériser l'habitude.
Pour
le surplus, les deux mandats à la base du litige, du 25 novembre 1991, ne
faisaient l'objet que d'une allusion, comme le déclare la Cour européenne
elle-même (§ 36). Une allusion ne constitue pas un moyen. Les exigences
du procès équitable n'obligent pas le juge à répondre à des allégations
vagues et imprécises exprimées en termes allusifs.
Mais,
l'arrêt Dulaurans paraît sans
lendemain.
10.
Dans son arrêt déjà cité du 29 août 2000, la Cour européenne a rejeté
un grief identique à celui de l'affaire Dulaurans
en se référant à une définition plus exacte de la notion de moyen.
Elle
a rappelé que l'irrecevabilité d'un moyen nouveau devant la Cour de cassation
n'était pas contraire au droit à un procès équitable, ce dont personne n'a
jamais douté. Mais surtout, la Cour européenne se réfère à une notion
stricte de moyen pour conclure que la Cour de cassation n'a pas commis d'erreur
manifeste d'appréciation en retenant la nouveauté. La Cour tient également à
souligner "que pour l'accomplissement de leur tâche, les tribunaux doivent
obtenir la coopération des parties qui, dans la mesure du possible, sont tenues
d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement
structurée".
On
peut considérer dans ces conditions l'arrêt Dulaurans
comme un accident corrigé par l'arrêt du 29 août 2000.
11.
Pour terminer, je voudrais signaler une jurisprudence qui, si elle est prise
à la lettre, devrait mettre les juridictions nationales, de première instance,
d'appel ou de cassation à l'abri de toute critique de la Cour européenne. Vous
savez en effet que les arrêts de la Cour de cassation comportent trois types de
motivation, la motivation normale qui est celle des arrêts généralement publiés,
la motivation abrégée qui répond de façon brève et précise aux griefs du
pourvoi, et enfin la motivation excessivement brève ou "tampon",
qui rejette le pourvoi par une formule stéréotypée sans la moindre référence
concrète à l'argumentation du demandeur. Cette formule est la suivante :
"
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui,
selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer
par la Cour de cassation la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles
de droit ;
"
Attendu que M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté
de sa demande tendant à ...
"
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de
fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui
sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être
accueillis".
Une
partie dont le pourvoi avait été rejeté par une telle formule a saisi la Cour
européenne en invoquant l'article 6 § 1 de la convention, en raison de ce que
l'arrêt ne répondait pas aux moyens présentés devant elle. La Cour européenne
a déclaré la requête irrecevable par une motivation encore plus brève, s'il
est possible. Cette motivation est ainsi formulée :
"
La Cour rappelle que si l'article 6 § 1 oblige les juges à motiver leurs décisions,
cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée
à chaque argument" (voir notamment l'arrêt Garcia
Ruiz c/ Espagne du 21 janvier 1999 ...). Elle constate que l'arrêt
litigieux fait référence aux quatre moyens développés par la requérante,
lesquels y sont de surcroît annexés. Elle relève par ailleurs qu'il ressort
clairement de l'arrêt que lesdits moyens ont été rejetés au motif qu'ils
soulevaient des questions de fait et non de droit et que la Cour de cassation ne
pouvait donc en connaître. Partant la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée en application de l'article 35 § 3 et 4 de la
convention" (CEDH, 20 juin 2000, req. n° 47.592/99, Nisse).
Autrement
dit, un arrêt est suffisamment motivé par le simple visa (sans résumé) des
moyens, leur agrafage en annexe de l'arrêt et la déclaration qu'ils sont mal
fondés. Si, dans l'affaire Dulaurans,
la Cour de cassation s'en était tenue à la formule tampon précitée, sans
faire aucun effort de motivation, elle se serait mise à l'abri de tout risque
de censure. C'est dire que la jurisprudence de la Cour européenne quant au degré
de motivation exigé des juridictions nationales n'est pas toujours d'une
parfaite lisibilité.
|